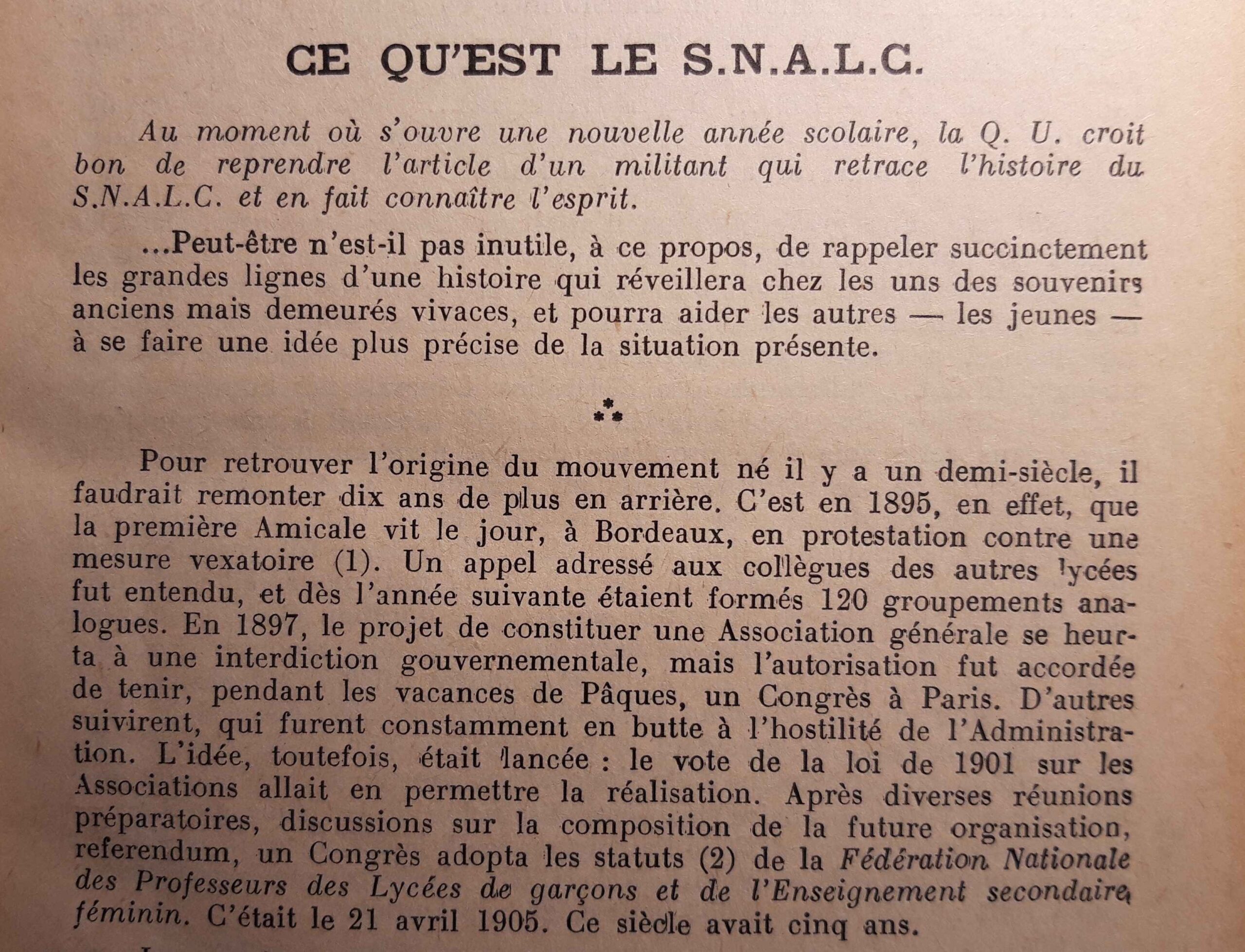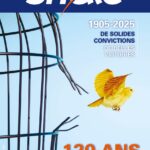Extrait de la QU n°521 du 1er octobre 1957, pages 3 à 7
Au moment où s’ouvre une nouvelle année scolaire, la Q. U. croit bon de reprendre l’article d’un militant qui retrace l’histoire du SNALC et en fait connaître l’esprit.
Peut-être n’est-il pas inutile, à ce propos, de rappeler succinctement les grandes lignes d’une histoire, qui réveillera chez les uns des souvenirs anciens, mais demeurés vivaces, et pourra aider les autres – les jeunes – à se faire une idée plus précise de la situation présente.
Pour retrouver l’origine du mouvement né il y a un demi-siècle, il faudrait remonter dix ans de plus en arrière. C’est en 1895, en effet, que la première Amicale vit le jour, à Bordeaux, en protestation contre une mesure vexatoire (1). Un appel adressé aux collègues des autres lycées fut entendu, et dès l’année suivante étaient formés 120 groupements analogues.
En 1897, le projet de constituer une Association générale se heurta à une interdiction gouvernementale, mais l’autorisation fut accordée de tenir, pendant les vacances de Pâques, un Congrès à Paris. D’autres suivirent, qui furent constamment en butte à l’hostilité de l ‘Administration. L’idée, toutefois, était lancée : le vote de la loi de 1901 sur les Associations allait en permettre la réalisation. Après diverses réunions préparatoires, discussions sur la composition de la future organisation, referendum, un Congrès adopta les statuts de la Fédération. Nationale des Professeurs des Lycées de garçons et de l’Enseignement secondaire féminin.
C’était le 21 avril 1905. Ce siècle avait cinq ans.
Le premier président de la Fédération fut Albert Fédel
On sait assez que plusieurs des réformes entreprises depuis quelques années dans l’enseignement secondaire n’ont pas eu d’autre cause que des raisons pécuniaires, et une préoccupation excessive d’économies à réaliser, au détriment de la légalité, de la valeur de l’enseignement et des intérêts les plus légitimes du corps enseignant.
Albert FEDEL, 1906
Le premier président de la Fédération fut Albert Fédel – naguère déplacé du lycée de Bordeaux, en raison de l’action qu’il y avait menée, par le directeur de l’enseignement secondaire Rabier. Il remplit ces fonctions pendant quinze ans. Son successeur, Fouquet, nommé par. le Congrès d’avril 1920, étant décédé accidentellement l’été suivant, Victor Copé fut, à la rentrée, appelé à la présidence, qu’il conservera jusqu’à sa mort, en 1937.
Cependant, la Fédération Nationale (A3) s’était rapidement développée.
Dès 1907, le nombre de ses membres s’élevait à 4.500. Il atteignait presque 5.500 à la veille de la guerre de 1914, au lendemain de laquelle, malgré les pertes éprouvées au cours de la tourmente, les mises à la retraite, le retard apporté par la mobilisation aux études de nombreux candidats à l’agrégation, il dépassait 4.800.
Un problème se posa alors : celui de la transformation des Amicales en Syndicats. Pareille décision avait déjà été prise par d’autres catégories du personnel enseignant, notamment les instituteurs et les professeurs de collèges. Le Congrès de Strasbourg institua un referendum qui donna en faveur de la transformation une majorité substantielle (un millier de voix environ), néanmoins inférieure aux 2/3 requis. La question fut reprise en 1925. La majorité des 2/3 ayant été cette fois atteinte, la Fédération fut transformée en Syndicat, placé sous le régime de la loi de 1884. L’A3 devint le S3 – les associations qui le composaient demeurant libres, soit de se constituer en S2 ou S1, soit de rester A2 ou A1. 1925… il y a trente ans… encore un anniversaire décennal ! Le cinquantenaire de notre organisation corporative est aussi le trentenaire de notre organisation syndicale.
L’adhésion à la C.G.T. est rejetée
Mais une autre grave question n’allait pas tarder à se poser. Dans les années qui suivirent, les autres catégories de l’Enseignement secondaire, professeurs de collèges, professeurs – adjoints et répétiteurs, maîtres d’internat, se joignirent aux syndicats des enseignements supérieur, primaire supérieur et primaire, pour former la Fédération Générale de l’Enseignement (F.G.E.), adhérente à la Fédération Générale des Fonctionnaires (F.G.F.), affiliée elle-même à la C.G.T. Le S3 devait-il à son tour s’engager dans cette voie P Le problème pouvait d’autant moins être éludé que plusieurs de ses membres faisaient également partie d’un Syndicat C.G.T. Il vint en discussion devant le Congrès de 1933. Comme l’avait été en 1920 la transformation en syndicat, l’adhésion fut écartée parce qu’elle n’obtint par la majorité des 2/3 (2.117 voix pour, 1.992 contre, 596 abstentions déclarées). L’année suivante, la question était de nouveau débattue en un Congrès extraordinaire qui, cette fois, repoussa explicitement l’adhésion à la F.G.F. par 3.105 voix contre 1.882 et 351 abstentions, vote à la suite duquel Edmond Lackenbacher, qui avait succédé à Copé, donna sa démission de président et fut remplacé par A.-M. Gossart. En 1937, enfin, au lendemain d’élections ayant amené à la Chambre une majorité de Front populaire, troisième discussion de la même question – qui de plus en plus, au-delà de l’appartenance à la F.G.E. ou à la F.G.F., était devenue celle de l’adhésion à la C.G.T. Majorité plus forte encore qu’en 1914 : 1.851 pour, 3.653 contre, 268 abstentions.
L’ouverture et le changement de nom
On assista alors à l’extension de deux syndicats distincts. D’une part, nos collègues minoritaires quittèrent le S3, et les quatre syndicats confédérés des professeurs de lycées, professeurs de collèges, professeurs – adjoints et répétiteurs, maîtres et maîtresses d’internat fusionnèrent en un « Syndicat du personnel de l’Enseignement secondaire » (S. P. E. S.), rattaché, par l’intermédiaire de la F. G. E., à la C. G. T.
D’autre part, en un Congrès extraordinaire tenu le 15 juillet 1937, la S3 décida, d’ouvrir ses portes à toutes les catégories de l’Enseignement secondaire masculin qui n’y étaient pas encore représentées (professeurs de collèges, professeurs – adjoints et répétiteurs, maîtres d’internat) et prit le nom – qu’il porte encore aujourd’hui – de « Syndicat National des Lycées, Collèges et cours secondaires ».
Deux ans après la scission de 1937, éclatait la seconde guerre mondiale. À partir de juin 1940, toute activité syndicale devait, pendant plus de quatre ans, être interdite en France. Les hostilités duraient encore – mais Paris et une grande portion du territoire étaient libérés – lorsque le 22 septembre 1944, au cours d’une réunion, tenue rue Las-Cases, à laquelle avaient été conviés les membres du Bureau du S3 et les présidents de S1 de la région parisienne, fut annoncée la fusion du S3 et du S.P.E.S. en un seul « Syndicat National de l’Enseignement Secondaire » (S.N.E.S.).
La scission et la naissance du S.N.E.S.
Il est impossible de méconnaître la valeur des arguments qui étaient invoqués. Nombre de militants des deux syndicats avaient, de longs mois durant, travaillé et lutté ensemble dans la Résistance : allaient-ils maintenant se séparer de nouveau en deux groupements différents et risquant d’être plus ou moins rivaux ? En outre, alors qu’une existence normale allait lentement reprendre dans la liberté enfin retrouvée, l’union de tous les membres de l’Enseignement secondaire n’était-elle pas plus opportune que jamais pour faire face aux problèmes de tout ordre qui se posaient au lendemain de la grande tourmente ?
Des difficultés, toutefois, surgirent dès le premier jour. Tout d’abord, plusieurs estimèrent que le S3 aurait dû se prononcer, dans les formes statutaires, sur une question aussi importante au lieu d’être brusquement placé en présence du fait déjà virtuellement accompli. Ensuite – peut-être surtout – le syndicat unique ainsi constitué se trouvait être affilié à la C.G.T., adhésion qu’à trois reprises en cinq ans les congrès S3 avaient repoussée à des majorités grandissantes.
Il s’ensuivit une période de confusion extrême. Insuffisamment informés – ou inexactement renseignés – beaucoup, en province surtout, crurent qu’il n’y avait plus qu’un seul syndicat, auquel ils adhérèrent d’autant plus volontiers qu’ils le regardaient comme la prolongation naturelle d’un S3 désormais confondu avec lui (2).
Aussi, quand se ranima la flamme que des soins diligents, notamment ceux de Mlle Combal, avaient empêché de mourir, quand après une période d’activité restreinte le S3 reprit en 1947, sous la présidence de Pétrus, une existence normale (3), avait-il cessé d’être – comme il l’était encore à la veille de la guerre (4) – le syndicat le plus représentatif de l ‘Enseignement secondaire. Qu’il demeure l’héritier direct de la tradition inaugurée en 1905, bien des indices concourent à l’attester, depuis les présidences honneur de Fedel et de Gossart jusqu’à, la permanence du même siège social (6). Malgré les progrès réalisés au cours de ces dernières années, il n’en est pas moins resté, par rapport au S.G.E.N. et au S.N.E.S., un syndicat minoritaire.
Est-ce à dire qu’il fasse aujourd’hui figure de vaincu ? Ce pourrait être le cas si l’on avait affaire, en la circonstance, à une simple concurrence entre trois groupements distincts. Mais il s’agit de tout autre chose. Et la cause que nous défendons dépasse infiniment les limites d’une compétition syndicale.
Vers la voie de l’autonomie
Il serait d’abord loisible d’observer qu’un héritage de notre ancien S3 apparut, dès le début, dans la dénomination du nouveau syndicat : c’est à lui que le S.P.E.S., devenu S.N.E.S., dut l’introduction, dans son titre même, de l’adjectif « national » ! Mais il y a beaucoup plus. Dès 1948, les Congrès du S.N.E.S. et de la F.E.N. (Fédération de l’Éducation Nationale) se détachèrent de la C.G.T. et décrétèrent leur autonomie. Preuve évidente que l’expérience n’avait pas tardé à justifier nos objections et nos craintes de naguère. Confirmation rétrospective de notre attitude passée. On peut l’affirmer sans grand risque de se tromper : si le S.N.E.S. avait été en 1944 ce qu’il devint quatre ans plus tard, c’est-à-dire autonome et indépendant de la C.G.T., la fusion projetée n’eût pas soulevé de difficultés décisives, et le S3 aurait fait partie intégrante du S.N.E.S.
Il serait vain de se le dissimuler : sur le plan inférieur – qui, encore une fois, ne fut et ne sera jamais le nôtre – de la concurrence numérique, la proclamation de l’autonomie du S.N.E.S. fut un obstacle à l’extension du S.N.A.L.C. Car c’est dans l’attente et l’espoir de cette autonomie que bien des collègues, dont plusieurs anciens membres du S3, restaient affiliés au S.N.E.S. « Nous y demeurons, disaient-ils en substance, pour apporter notre suffrage à l’autonomie que beaucoup maintenant réclament ; si elle est repoussée, nous viendrons au S.N.A.L.C. ». Elle fut votée : ils restèrent au S.N.E.S. Leur attitude était parfaitement logique, et l’on ne saurait guère trouver à y redire.
Ainsi donc, matériellement préjudiciable au S.N.A.L.C., l’autonomie du S.N.E.S. fut pour lui une victoire morale, en tant qu’elle marquait la prédominance de dispositions et de préoccupations dans lesquelles il reconnaissait son propre esprit. Elle constituait, entre celui-ci et celui-là, un rapprochement incontestable.
Une différence pourtant subsiste, qui continue à donner au S.N.A.L.C. une vivante raison d’être. Seul parmi les syndicats de l’Enseignement secondaire, il n’est pas rattaché à une Fédération d’enseignants plus vaste où il formerait une minorité exposée – on a pu le constater ailleurs, à subir la foi du nombre. Seul, il a l’assurance de pouvoir, en toute circonstance, faire entendre directement la voix de l’Enseignement secondaire sans avoir à redouter la moindre entrave du fait de groupements voisins coexistants. Son affiliation, l’an dernier, à la Confédération Générale des Cadres par l’intermédiaire de la Fédération Générale des Cadres Fonctionnaires ne menace en rien à cet égard son indépendance. Verrons-nous, ici encore, la ligne de conduite du S.N.A.L.C. adoptée par d’autres ? Après avoir conquis, vis-à-vis de la C.G.T., ce que l’on pourrait appeler une autonomie externe, le S.N.E.S., pour se libérer lui aussi de la loi du nombre, réalisera-t-il une autonomie interne en se dissociant de la F.E.N. ? Si tel devait être un jour le cas, peut-être y aurait-il là, pour le S.N.A.L.C., une invite à reconsidérer l’ensemble de la situation avec d’autant plus de sérénité qu’il serait en droit de reconnaître et de saluer, dans l’évolution survenue, une manifestation de l’esprit et une application des principes qui de longue date n’avaient cessés d’être les siens.
L’héritage du passé
« De longue date »… Puisqu’un cinquantenaire est l’occasion de méditer sur la signification et sur la valeur de l’héritage légué par un passé, recueillons les leçons de cette histoire d’un demi-siècle. Bien des figures repassent devant nos yeux. Renouvelons – en y associant notre président actuels et ses collègues du Bureau – l’hommage qu’au banquet du 4 avril Mériaux rendait à nos anciens chefs de file : notre cher et vénéré doyen Fedel, dont l’absence pour raisons de santé fut ce jour-là unanimement regrettée – Cope, à la haute taille et à l’aimable sourire, dont il n’est pas exagéré de dire qu’il est mort à la tâche – Lackenbacher, noble et courageuse victime de la dernière guerre – Gossart, qui naguère présidait avec une autorité à la fois si ferme et si affable des débats mouvementés dont le souvenir ne va pas aujourd’hui sans quelque nostalgie. Petrus, qui vaillamment, au lendemain de la libération, accepta la charge souvent ingrate d’une patiente remise en marche.
Et puis, forts de ces inspirations et de ces exemples, tournons-nous vers l’avenir. Ce que nous avons à défendre, ce n’est pas l’existence d’un syndicat, mais les fins permanentes et souveraines au service desquelles il n’est qu’un moyen. Les formes du combat pourront changer, mais son enjeu reste le même – ou plutôt, devant les menaces conjuguées des techniques envahissantes, des conformismes niveleurs et des totalitarismes asservissants, il ne fait que grandir en urgence et en portée. Car il ne s’agit de rien moins, en définitive, que de sauvegarder les conditions de tout ordre grâce auxquelles l’Enseignement secondaire français travaillera à entretenir, au sein de la jeunesse qui lui est confiée, ces qualités d’intelligence et de caractère, d’esprit critique et de conscience morale, de liberté dans la pensée et d’efficacité dans l’action, qui font la dignité de l’homme et le sens de la vie.
Quelles que soient les circonstances, toujours retentira devant nous ce pressant appel. Comme on lui demandait où il allait désormais diriger ses pas, Livingstone répondit un jour : « N’importe où, pourvu que ce soit en avant ! »
Gérard MONOD
(1) : Il s’agissait d’une circulaire supprimant pour les fils de professeurs l’exonération des frais d’études à. laquelle ils avaient jusqu’alors eu droit.
(2) : Outre cette cause primordiale, d’autres facteurs jouèrent également un rôle. Preuve en soit cette circulaire ministérielle décrétant que les délégués des professeurs dans les comités d’épuration devaient avoir appartenu au S.P.E.S. ou être membre du S.N.E.S.
(3) : C’est en 1948 que la Q. U. retrouva son titre et son format d’autrefois, l’abréviation S.N.A.L.C. vint ensuite
(4) : En 1937, les candidats agrégés du S3 étaient élus au Comité consultatif avec une majorité de 500 voix environ sur ceux du S.P.E.S
(5) : On pourrait allonger la liste des signes concordants : même numéro de téléphone, même compte de chèques-postaux, etc.
C’est parce qu’on a cru qu’on pouvait tout se permettre contre nous […] que l’on a créé parmi nous l’état d’esprit qui a fait naître notre Fédération.
Albert FEDEL, 1911