Dossier du mois de la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1507 du 28 novembre 2025.
Sommaire
REBOOTER LE SYSTÈME
La valse à mille ministres se poursuit à l’Éducation nationale. Comme à chaque changement, le SNALC a rencontré le nouveau locataire de la rue de Grenelle et a porté des revendications fortes en termes de rémunération et de conditions de travail, mais aussi de pédagogie. Le SNALC a encore une fois plaidé, propositions à l’appui, pour un meilleur traitement des collègues et pour une meilleure qualité d’enseignement.
Pour le SNALC, l’immense majorité des réformes pédagogiques de ces dernières années, de l’école primaire au lycée (général, technologique ou professionnel) jusqu’à celle, en cours, de la formation initiale, ont abîmé ou s’apprêtent à abîmer notre métier et ont eu des conséquences nulles ou néfastes pour la formation de nos élèves.
Les différentes enquêtes que nous avons menées lors de la réforme du baccalauréat ou lors de la mise en place des groupes au collège n’ont fait que confirmer nos analyses.
Aujourd’hui, notre système scolaire est en crise. Les métiers de l’enseignement n’attirent plus. Nos élèves ont de plus en plus de difficultés. Le SNALC alerte et fait des propositions, mais il ne voit rien venir.
Notre époque s’y prête : alors que le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies et dans notre système éducatif, osons la métaphore filée, quitte à pousser jusqu’à l’allégorie. Les mises à jour et les dernières installations de logiciels par les ministres successifs à la tête de l’Éducation nationale, n’ont cessé d’en dégrader l’environnement et les performances, jusqu’à la mettre en échec. Que faire dans un tel contexte ? Le diagnostic des experts est sans appel : il faut rebooter le système.
Pour le SNALC, c’est en effet le seul moyen de le redémarrer. Mais attention à la précipitation et à une conception trop verticale de la prise de décisions ! Le Ministère doit enfin prendre le temps d’écouter les personnels du terrain et leurs représentants sans circonscrire les concertations aux encadrants, aux DASEN et aux recteurs, qui ne sont pas forcément les mieux placés pour capter tous les signes de dysfonctionnement. Or, les messages d’erreur et pop-ups inattendus ne manquent pas… Le SNALC propose son diagnostic : analyse antivirus, vérification du matériel, bilan des défaillances et suggestions de solutions pour réinstaller un système d’exploitation performant.
FORMATION INITIALE : MAUVAIS LOGICIEL D’INSTALLATION
 À l’origine de la réforme de la formation initiale, le Ministère a annoncé vouloir créer un choc d’attractivité tout en outillant mieux les futurs personnels pour leurs métiers.
À l’origine de la réforme de la formation initiale, le Ministère a annoncé vouloir créer un choc d’attractivité tout en outillant mieux les futurs personnels pour leurs métiers.
Pleinement en accord sur les objectifs, le SNALC considère qu’ils ne peuvent être atteints que par une revalorisation financière et par une formation qui redonne du sens au métier.
Sur le premier aspect, avec 1 400 euros par mois, en Master 1 pour de l’observation et de la pratique accompagnée puis 1 800 euros en Master 2 où la formation côtoie l’enseignement, il faut reconnaître que l’on n’est pas loin du compte. Malheureusement, le Ministère a conditionné l’octroi de ces rémunérations à l’obligation de rester quatre ans dans l’Éducation nationale après la titularisation, ce qui peut rebuter certains candidats. Par ailleurs, il a établi le volume d’enseignement en M2 à 50 % du temps de formation. Pour le SNALC, cette quotité est trop importante : un tiers d’enseignement aurait été largement suffisant.
Concernant l’orientation donnée au métier, la place réduite accordée aux connaissances dans les contenus de formation inquiète fortement le SNALC. Même si la communication ministérielle affirme le contraire, force est de constater que sur quatre blocs, un seul est consacré aux contenus disciplinaires et qu’il fait en outre la part belle à la didactique. Sachant que le deuxième bloc est entièrement dédié à la pédagogie, on sent bien qu’un tel déséquilibre traduit la volonté ministérielle de normer les pratiques.
La lecture du projet de référentiel de compétences n’est pas faite pour rassurer à cet égard. Le professeur doit-il avoir pour seule ambition de « disposer des connaissances pour enseigner les programmes ? » À l’heure où l’image du métier est de plus en plus dégradée dans notre société, envoyer le message que l’enseignant n’est pas un spécialiste de sa discipline et qu’un niveau à peine plus élevé que celui des élèves suffit pour animer une classe paraît désastreux et bien peu fait pour redorer le blason d’une profession en crise.
Pour lutter contre cette dévalorisation de notre métier, le SNALC donc a clairement demandé au Ministre des modifications sur la formation dispensée aux futurs enseignants : l’accent doit être clairement mis sur l’expertise du professeur et la qualité de sa formation disciplinaire.
PREMIER DEGRÉ : DES PROGRAMMES QUI PLANTENT
Ces deux dernières années, le ministère a rénové les programmes du cycle 1 au cycle 3. Or, il suffit de consulter les programmes de français ou de mathématiques, voire les projets de programmes de langues vivantes pour se rendre compte qu’ils ont tous les mêmes défauts.
Dès la prise en main, une constatation s’impose : ces programmes ne maîtrisent pas l’art de la synthèse et il faut désormais des dizaines de pages pour exprimer ce qui aurait pu tenir en une seule.
Outre les redondances, les fichiers sont en effet alourdis par des données inutiles qui ralentissent la lecture ou pire encore, ajoutent des contraintes aux professeurs, sans profit pour les élèves :
- une colonne de droite intitulée « exemples de réussite » donne des explications qui relèveraient plutôt de documents d’accompagnement ou explique aux professeurs quelles activités mettre en œuvre dans leurs classes ;
- des points de vigilance précèdent chaque partie des programmes de français pour s’assurer que les professeurs enseignent bien comme le Ministère le souhaite.
Pour le SNALC, ces précisions qui alourdissent les programmes sont également inacceptables lorsqu’elles se présentent comme impératives. Les programmes ont vocation à définir les contenus à enseigner, pas les modalités de leur transmission qui relèvent de l’expertise du professeur seul à même d’adapter sa pédagogie aux besoins de ses élèves. Il ne faudrait pas en outre que ces prescriptions intempestives deviennent opposables pour des parents procéduriers qui en viendraient à reprocher au professeur de ne pas employer exactement la méthode mentionnée dans les documents officiels.
Pour le SNALC, il faut que le Ministère ait confiance en ceux qui le font fonctionner, chaque jour, par leur professionnalisme et leur investissement pour la réussite de leurs élèves. Sans cela, les programmes ne vont pas tourner mais planter.
COLLÈGE : ERREUR SYSTÈME OU CHEVAL DE TROIE ?
Toutes les applications numériques ne sont pas inintéressantes. De même, dans l’écosystème Éducation nationale, le projet de groupes au collège pouvait apparaître comme un moyen intéressant de lutter contre les effets délétères de la trop grande hétérogénéité des classes notamment en sixième. Accompagné d’investissements pour aider les élèves en difficulté avec des groupes à effectifs réduits, il aurait même pu constituer une mise à jour bénéfique des paramètres de configuration du collège.
Or, dans la réalité, faute de moyens suffisants, l’ambition de réduire l’hétérogénéité constatée par près de 90 % des professeurs de collège, a été abandonnée. Seules demeurent les contraintes liées aux emplois du temps et à la progression commune, erreurs de configuration ou données inutiles qui ralentissent le système.
Le SNALC n’a pas pour habitude de crier au loup ou au grand complot. On peut néanmoins s’interroger : l’échec résulte-t-il d’un simple accident industriel, fruit d’hésitations et de reculades ou un objectif inavoué présidait-il à cette réforme?
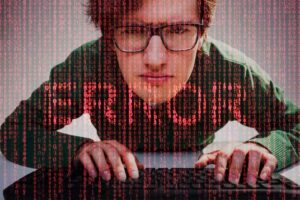
Ce qui demeure du dispositif originel et les propos de l’inspection générale et de l’IH2EF ne laissent guère de place au doute. Derrière l’objectif affiché d’améliorer le niveau des élèves, c’est la volonté de normer les pratiques qui a réellement été mise en avant. L’installation du logiciel a davantage obligé les professeurs à se réunir pour organiser leurs progressions et harmoniser leurs évaluations qu’elle n’a entraîné la constitution de groupes pertinents et à effectifs réduits si nécessaire.
Pour le SNALC, cette standardisation du code pédagogique qui entraîne réunions inutiles et tâches chronophages pour les professeurs, sans aucun profit pour les élèves doit être désinstallée.
Lors d’une audience bilatérale, nous avons donc demandé solennellement au ministre de supprimer ce logiciel malveillant de notre système. Nous avons aussi rappelé qu’à l’heure du numérique et de l’IA, la suppression de l’heure de technologie en 6e était un bug historique majeur. Elle doit être restaurée.
M. Geffray a répondu qu’une réflexion était en cours : les collèges pourraient choisir à l’avenir de mettre en place les groupes. Ils ne seront pas étendus aux autres classes. Sur l’heure de technologie, le dialogue est malheureusement bloqué pour le moment. Le SNALC continuera à se battre pour une véritable mise à jour d’un système dont les performances laissent à désirer faute de véritable investissement dans une maintenance de qualité.
BACCALAURÉAT : L’AJOUT DE PATCHS NE RÉSOUT RIEN (AU CONTRAIRE)
Dès sa conception, le nouveau baccalauréat ne tenait pas la route. Le SNALC n’a cessé de le répéter et de demander au Ministère d’être raisonnable en revenant sur sa réforme. Sans succès malheureusement.
Depuis, les différents ministres qui se sont succédé ont tous modifié le code source du baccalauréat ou ajouté des modifications qui n’ont, souvent, fait qu’empirer les choses.
Certes, le retrait des E3C a été une avancée, mais ensuite, les patchs ont tous fait pschitt.
 Le tout premier ajout, suggéré par un syndicat bien mal inspiré, avait pour objectif de réguler le contrôle continu par l’introduction d’un projet d’évaluation. En guise de régulation, le SNALC a surtout constaté une tentative de mainmise sur l’évaluation des professeurs par l’inspection générale. Les contraintes qui se sont multipliées sont désormais matérialisées par la note de service du 25 août 2025. Le SNALC a demandé l’abrogation de cette note de service ; elle contrevient en effet à l’arrêté dont elle découle en intégrant dans le dispositif, Parcoursup oblige, les spécialités qui ne relèvent pourtant pas du contrôle continu pour le baccalauréat.
Le tout premier ajout, suggéré par un syndicat bien mal inspiré, avait pour objectif de réguler le contrôle continu par l’introduction d’un projet d’évaluation. En guise de régulation, le SNALC a surtout constaté une tentative de mainmise sur l’évaluation des professeurs par l’inspection générale. Les contraintes qui se sont multipliées sont désormais matérialisées par la note de service du 25 août 2025. Le SNALC a demandé l’abrogation de cette note de service ; elle contrevient en effet à l’arrêté dont elle découle en intégrant dans le dispositif, Parcoursup oblige, les spécialités qui ne relèvent pourtant pas du contrôle continu pour le baccalauréat.
Autre patch : l’ajout de l’épreuve anticipée de culture mathématique. Pour répondre à une commande du supérieur –Sciences Po notamment–, cette discipline a été sortie du droit commun avec des inconvénients à prévoir sur l’organisation du baccalauréat. Les dysfonctionnements sont déjà nombreux : entre les épreuves anticipées, les spécialités et le Grand oral, les professeurs subissent déjà des convocations multiples. Chaque année, le SNALC tente de réduire leurs effets sur les conditions de travail des collègues en jouant sur le calendrier des épreuves, mais la marge de manœuvre est extrêmement réduite.
Le SNALC demande le retour à des épreuves nationales, terminales et anonymes, la révision totale des épreuves anticipées de français et une réflexion approfondie sur la place des mathématiques et sur le Grand oral.
VOIE PROFESSIONNELLE : TOUT RÉINSTALLER, DU SYSTÈME AUX PROGRAMMES
La voie professionnelle est sans doute la partie du système scolaire qui a été la plus touchée par les modifications de ces dernières années.
Dès la suppression d’une année d’étude pour l’obtention du baccalauréat, le SNALC avait alerté sur la baisse prévisible des acquis des élèves tant du point de vue professionnel que du point de vue de la culture dite générale.
Les modifications intervenues depuis n’ont fait qu’empirer la situation.
Ainsi, les mentions complémentaires devenues certificats de spécialisation visant à améliorer les compétences professionnelles se sont multipliées, mais sans que leur soit associé un niveau de qualification supérieur. Certains élèves de la voie professionnelle suivent donc une année supplémentaire après le dernier diplôme obtenu tout en conservant le même niveau de recrutement correspondant à ce diplôme. Sachant que les certificats de spécialisation les plus recherchés sont accessibles aux bacheliers généraux ou technologiques et aux adultes de moins de 30 ans via l’apprentissage, les diplômés de la voie professionnelle pâtissent d’un double effet d’éviction parfaitement injuste, à la fois lors de l’entrée en formation et lors de l’accès à l’emploi.
Il faut ajouter que le diplôme a été dévalorisé par la généralisation des épreuves en CCF qui rognent par ailleurs sur le temps d’enseignement et alourdissent la charge de travail des professeurs ?
Enfin, comment ne pas parler du fameux parcours en Y qui a complètement planté les lycées professionnels en fin d’année avec un absentéisme allant jusqu’à 90 % ? Malgré ce dysfonctionnement majeur, le Ministère a prévu, pour cette année scolaire, d’en redéployer une nouvelle version sans corriger le code source à l’origine du plantage.
Le SNALC demande que le Ministère rouvre les négociations afin de revenir sur tous ces dysfonctionnements et de d’élever réellement le niveau de qualification, de connaissance et de compétences de jeunes qui méritent un meilleur avenir. Cela devra nécessairement s’accompagner d’une vraie réflexion – enfin – sur tous les moyens à mettre en œuvre, dans l’amont, avec l’orientation, comme dans le fonctionnement des CAP et baccalauréats professionnels, pour que les termes « voie de l’excellence » cessent d’être un vœu pieux.
INCLUSION : L’INSTALLATION QUI CRÉE DES CONFLITS À RÉPÉTITION
Dans le domaine informatique, lorsqu’un programme est mal conçu, truffé de lignes de code susceptibles de provoquer des bugs ou d’entrer en conflit avec d’autres logiciels, les concepteurs ont l’intelligence de ne pas le commercialiser.
L’Éducation nationale n’a malheureusement pas la même clairvoyance.
Ainsi, après la loi de 2005, l’inclusion scolaire s’est développée dans notre institution. Le SNALC a alors été le seul à affirmer que, telle qu’on voulait la mettre en place, elle ne fonctionnerait pas, quand beaucoup préféraient s’aveugler comme devant une trouvaille visionnaire à la Steve Jobs.

Nous avons osé dire que décréter l’inclusion avec pour véritable objectif de réduire les places en médicosocial sans créer ni adapter les structures nécessaires, relevait non seulement de l’erreur, mais même d’une forme de cynisme.
Depuis, l’inclusion s’est installée telle qu’elle avait été pensée, sans la moindre remise en question de la part du Ministère. Elle repose sur des enseignants non formés auxquels on confie des missions contradictoires, et sur des AESH tout aussi insuffisamment formés, précarisés et sous-payés faute de statut. La conséquence ? Des élèves « inclus » qui ne le sont qu’en apparence, en souffrance dans des classes où leurs camarades subissent eux aussi les effets d’un dispositif mal conçu.
Le problème, c’est que la version 3.0 du système, avec les PAS, promet d’aller encore plus loin tout en aggravant les problèmes d’incompatibilité. Les AESH devraient en principe rester auprès des élèves en situation de handicap, toujours sans moyens suffisants, mais l’inclusion devrait désormais concerner tous les élèves à besoins éducatifs particuliers – vaste programme ! – en intégrant divers acteurs du médicosocial amenés à travailler avec les professeurs, CPE, Psy-EN.
Personne n’est réellement capable d’expliquer ce que sont les PAS, mais pour leurs concepteurs, c’est forcément une avancée formidable. Le SNALC, lui, demande, de prendre le temps de réfléchir avant de lancer cette nouvelle version et de travailler enfin à la création d’une application fonctionnelle.
CONTENUS D’ENSEIGNEMENT : SATURATION DU DISQUE DUR
 Les programmes les plus récents, du primaire au lycée en passant par le collège, ont un point commun : ils sont chargés et leur rédaction est souvent touffue. Ce n’est pas cet aspect cependant qui préoccupe le plus le SNALC.
Les programmes les plus récents, du primaire au lycée en passant par le collège, ont un point commun : ils sont chargés et leur rédaction est souvent touffue. Ce n’est pas cet aspect cependant qui préoccupe le plus le SNALC.
En effet, comme dans un ordinateur, les programmes de base peuvent tourner correctement, même lorsqu’ils prennent de la place et consomment de la mémoire vive. Mais si l’utilisateur s’évertue à ajouter sans cesse d’autres logiciels susceptibles de saturer le disque dur, le système risque fort de ramer voire de planter totalement.
Pour le SNALC, c’est exactement ce que subit notre système depuis que l’Éducation nationale est appelée à la rescousse pour répondre à toutes les demandes sociétales.
Elle doit ainsi désormais éduquer les élèves aux enjeux climatiques et environnementaux, aux dangers des réseaux et des fake-news, au vivre-ensemble, à l’orientation, aux compétences psychosociales ou encore à la vie affective et sexuelle… Certes, ces questions ne sont pas négligeables dans la formation de futurs citoyens, mais doivent-elles être traitées en rognant sur les enseignements ? Il n’est pas rare en effet de voir des heures de cours disparaître pour l’intervention d’une association ou d’un spécialiste.
Pour le SNALC, cette multiplication des objectifs assignés à l’École risque de nuire à la qualité de l’enseignement dispensé en faisant bon marché du temps nécessaire à la construction des connaissances. En outre, l’École ne devrait pas avoir le monopole éducatif et se substituer à tous les intervenants pertinents du monde associatif notamment
C’est en ce sens qu’une réflexion doit être menée de manière globale pour que chacun ait sa place et joue son rôle éducatif. Pour éviter la surchauffe du système, le rôle de l’École doit être clairement défini.
PROFESSEURS : NE PAS CRÉER UNE MATRICE
Pour clore ce parallèle entre notre système éducatif et un système informatique, osons un détour par la culture populaire moderne et un film particulièrement emblématique : Matrix. Dans cette dystopie, le système contrôlé par des machines tient par l’intervention de programmes, les Agents. Personnages vêtus de la même manière avec un costume, une cravate, des lunettes de soleil et une oreillette, ils sont en communication constante entre eux et avec l’unité centrale.
 Or, si le SNALC avait une hantise ce serait celle-là : voir les professeurs transformés en Agents. N’est-ce pas mutatis mutandis le projet du Ministère ?
Or, si le SNALC avait une hantise ce serait celle-là : voir les professeurs transformés en Agents. N’est-ce pas mutatis mutandis le projet du Ministère ?
Formation initiale, programmes, groupes au collège, projet d’évaluation du baccalauréat, toutes les réformes de ces dernières années convergent en effet vers un même point : la standardisation des pratiques via des progressions communes et des évaluations extrêmement normées. Dans un tel système, les professeurs peuvent apparaître comme des pions interchangeables fonctionnant au même rythme selon les mêmes modalités stéréotypées.
C’est une tout autre conception du métier que défend le SNALC. Exerçant un métier intellectuel et fort d’un niveau disciplinaire indiscutable, le professeur doit rester le concepteur de ses cours en mettant sa liberté pédagogique au service de ses élèves. Pour cela, il doit être armé conceptuellement, maîtriser diverses techniques pédagogiques sans être enfermé dans un fonctionnement unique et avoir la possibilité de d’adapter sa pédagogie selon ses élèves et leurs acquis.
Pour filer la métaphore de Matrix, le professeur serait plutôt un Néo qu’un agent… soit le héros du film, appelé à sortir ses semblables de l’ignorance pour les élever vers le Savoir. Grandiloquent ? À peine pour le SNALC qui a toujours eu pour ambition de porter les élèves au plus haut de leurs capacités.







