Dossier du mois de la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1505 du 3 octobre 2025.
Dossier coordonné par Solange DE JÉSUS, membre du Bureau national du SNALC chargée des principes et valeurs de la République. Avec la contribution de Laurent BONNIN, responsable national du secteur juridique du SNALC.
Sommaire
MIEUX AGIR POUR LA LAÏCITÉ
Agir. Voilà ce qu’attendent les personnels de l’Institution. Agir pour sortir enfin de cette torpeur, de cette sorte d’impuissance programmée face aux assauts répétés contre l’école laïque et ses représentants. Pour apporter l’indispensable soutien, la nécessaire protection à ceux dont le quotidien est susceptible de basculer à tout moment sous la pression des intimidations et des menaces. La rentrée, endeuillée par le suicide de notre collègue directrice d’école, Caroline Grandjean, victime d’abjectes attaques homophobes, révèle une fois de plus, et de façon tragique, un échec dans l’action. Une fois de trop.
 À tous les niveaux, l’École est aux prises avec des entraves à ses missions : contestations d’enseignement aboutissant à l’autocensure croissante des professeurs, remise en cause de la liberté pédagogique et académique, relatif manque de fermeté de la hiérarchie… Dans le premier et le second degré, les tentatives de psychologiser les programmes conduisent à un dévoiement des savoirs en prétendant se positionner en surplomb de ceux-ci. Tandis qu’en parallèle, sous couvert de bons sentiments, les valeurs républicaines font ici et là l’objet de déconstruction sémantique. Face à cet affaissement à la fois éthique et intellectuel qui s’accompagne d’une montée sans précédent des discriminations, la laïcité n’a jamais semblé aussi précieuse et s’impose comme une évidence.
À tous les niveaux, l’École est aux prises avec des entraves à ses missions : contestations d’enseignement aboutissant à l’autocensure croissante des professeurs, remise en cause de la liberté pédagogique et académique, relatif manque de fermeté de la hiérarchie… Dans le premier et le second degré, les tentatives de psychologiser les programmes conduisent à un dévoiement des savoirs en prétendant se positionner en surplomb de ceux-ci. Tandis qu’en parallèle, sous couvert de bons sentiments, les valeurs républicaines font ici et là l’objet de déconstruction sémantique. Face à cet affaissement à la fois éthique et intellectuel qui s’accompagne d’une montée sans précédent des discriminations, la laïcité n’a jamais semblé aussi précieuse et s’impose comme une évidence.
Le SNALC, lui, n’est pas dupe. Conscient de l’urgence de défendre la laïcité et les personnels qui la font vivre, il vient à votre rencontre lors de ses congrès. Vous y trouverez un espace de liberté d’expression en même temps que les moyens pédagogiques et juridiques pour vous aider à préserver la puissance émancipatrice de l’École, lieu d’éducation à la liberté.
À rebours des faux-fuyants enrobés de discours convenus qui empêchent les personnels d’accomplir leur tâche en conformité avec le véritable sens de leur métier, le SNALC se bat pour mieux agir dans l’intérêt des élèves comme dans celui des agents. C’est sa raison d’être originaire, à laquelle nous n’avons jamais dérogé.
LA LAÏCITÉ, CONDITION DE LA LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE
 Fidèle au programme émancipateur de l’École, la liberté pédagogique fait écho à la devise républicaine : « liberté-égalité-fraternité », trois mots reliés par des traits d’union qui marquent leur caractère indissociable et complémentaire. L’École a pour rôle de faire advenir les conditions de réalisation d’un tel idéal. Lieu où l’on enseigne les savoirs, elle est par sa nature même un lieu d’éducation à la liberté. En offrant à tous les élèves la possibilité de l’émancipation, elle les considère comme des citoyens en devenir, et cela pas seulement en tant qu’individus.
Fidèle au programme émancipateur de l’École, la liberté pédagogique fait écho à la devise républicaine : « liberté-égalité-fraternité », trois mots reliés par des traits d’union qui marquent leur caractère indissociable et complémentaire. L’École a pour rôle de faire advenir les conditions de réalisation d’un tel idéal. Lieu où l’on enseigne les savoirs, elle est par sa nature même un lieu d’éducation à la liberté. En offrant à tous les élèves la possibilité de l’émancipation, elle les considère comme des citoyens en devenir, et cela pas seulement en tant qu’individus.
Les textes législatifs confortent cette mission de l’École. Le Code de l’éducation prévoit la liberté d’expression des élèves (L512-2), qui s’accompagne d’autres libertés telles que la liberté d’information, de réunion (R511-1 à R511-11) – toutes encadrées par la loi.
L’École enseigne donc la pratique de la liberté, sans toutefois l’imposer : en effet elle ne s’érige pas contre les croyances des élèves. En revanche, elle distingue nettement ce qui est de l’ordre de la connaissance de ce qui relève de la croyance. Parce qu’un programme n’est pas défini à l’aune d’une culture ou d’une croyance particulières, mais en fonction d’un objet pour lequel il y a lieu d’enseigner. Ainsi nul élève, nul parent ne peut se prévaloir de sa croyance pour refuser un enseignement (cf. articles 12 et 13 de la charte de laïcité), tel, par exemple, celui de la théorie darwinienne de l’évolution. C’est une vérité scientifique, donc cela s’enseigne.
De quelle manière laïcité et savoirs sont-ils liés ?
Savoir et raison sont des facultés à l’œuvre dans l’enseignement des disciplines. L’histoire rappelle que c’est d’abord par les programmes que l’enseignement a été débarrassé de tout fondement religieux. Des manuels scolaires fondés sur des savoirs vérifiés sont alors édités.
La laïcité assure à la fois la neutralité axiologique de la recherche et la scientificité des programmes, eux-mêmes constitutifs de l’idée de Nation, car ils participent à l’élaboration d’une culture commune à tous, par l’universalité des savoirs dispensés – un universalisme que promeut précisément la laïcité.
Programmes et liberté pédagogique
 Les programmes, nationaux et rendus publics sur le site du ministère, constituent le cadre à l’intérieur duquel la liberté pédagogique du professeur va s’articuler (Article L912-1-1 du code de l’éducation.) Ce dernier conserve, en principe, une liberté totale dans le choix de sa pédagogie du moment qu’il enseigne rigoureusement sa discipline en respectant le programme. Le SNALC s’est toujours battu avec opiniâtreté pour défendre cette liberté face aux multiples tentatives de coercition du ministère[1].
Les programmes, nationaux et rendus publics sur le site du ministère, constituent le cadre à l’intérieur duquel la liberté pédagogique du professeur va s’articuler (Article L912-1-1 du code de l’éducation.) Ce dernier conserve, en principe, une liberté totale dans le choix de sa pédagogie du moment qu’il enseigne rigoureusement sa discipline en respectant le programme. Le SNALC s’est toujours battu avec opiniâtreté pour défendre cette liberté face aux multiples tentatives de coercition du ministère[1].
Relisons le grand pédagogue Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire de 1879 à 1896, qui démontre en quoi la liberté pédagogique est fondamentale dans la transmission des savoirs :
« Croire, c’est ce qu’il y a de plus facile ; et penser, ce qu’il y a de plus difficile au monde. Pour arriver à juger par soi-même d’après la raison, il faut un long et minutieux apprentissage ; cela demande des années, cela suppose un exercice méthodique et prolongé.
C’est qu’il ne s’agit rien moins que de faire un esprit libre. Et si vous voulez faire un esprit libre, qui est-ce qui doit s’en charger sinon un autre esprit libre ? Et comment celui-ci formera-t-il celui-là ? Il lui apprendra la liberté en la lui faisant pratiquer. […]
Il n’y a pas d’éducation libérale là où l’on ne met pas l’intelligence en face d’affirmations diverses, d’opinions contraires, en présence du pour et du contre, en lui disant : compare, et choisis toi-même ! »
Ainsi, la Loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction des tenues et signes religieux ostensibles participe de la liberté d’enseigner et de la liberté pédagogique : elle préserve la sérénité des enseignements tout en permettant aux élèves d’expérimenter un recul par rapport à leurs croyances, dans le but de les préparer à exercer leur libre arbitre une fois devenus adultes.
La laïcité est d’abord une liberté que l’École promeut auprès des élèves (Article L111-1 du code de l’éducation). La liberté pédagogique s’inscrit donc pleinement dans l’enseignement, grâce à la laïcité.
[1] Voir notre article : https://snalc.fr/baccalaureat-nds-r25/
PROMOUVOIR UNE « ÉCOLE DE LA FRATERNITÉ » … VIA LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES ?
Il fallait oser. Le guide Vers une École de la fraternité, publié par le Conseil des sages de la laïcité, offre un parcours inattendu. Son but ? Promouvoir une « pédagogie de la fraternité ». Une intention a priori louable, mue par le constat d’une École où la fraternité ferait défaut, à l’image de la société qui l’entoure – affirmation alimentée par des lieux communs mais dépourvue d’analyse.
Le guide s’ouvre sur une fleur de la fraternité qui fait entrer de plain-pied dans les compétences psychosociales. Sans jamais faire l’objet d’une définition claire, celle-ci est mêlée sans distinction conceptuelle à diverses notions telles que tolérance, empathie, camaraderie, …
L’ambition du « guide » est de placer la fraternité au cœur d’un « grand projet éthique » qui résiderait dans sa prise de conscience par le simple fait de l’expliciter et de la nommer. À croire que le triptyque républicain ornant le fronton de toutes les écoles a échappé à la vigilance des auteurs ? Ou que l’École elle-même ne serait pas un « grand projet éthique » ? Quant à leur méthode pour susciter la fraternité, elle se résume en une formule incantatoire : « Osons la nommer […] pour qu’elle advienne véritablement. » Abracadabra !
Le SNALC déplore que la notion de fraternité serve de prétexte à justifier les compétences psychosociales qui irriguent les nouveaux projets de programmes, et oblitèrent la fonction proprement politique de l’École comme préparation à une citoyenneté éclairée. À la différence des autres vade-mecum du CSL, dont le SNALC a déjà dit tout le bien qu’il pensait, on cherchera vainement dans celui-ci des fiches pratiques ou des solutions concrètes pour faire face aux contestations qui ne manquent pourtant pas de surgir régulièrement en classe. Tout au plus y trouvera-t-on la connexion entre les programmes, les CPS et autres parcours éducatifs.
Parmi les chapitres dédiés aux disciplines, celui concernant la philosophie est frappant de paradoxe. Le seul et unique texte cité, de la plume de Bergson, fait figurer Dieu comme fondement de la fraternité. Or, l’absence de mise en perspective d’une position si partisane avec d’autres philosophes athées ou agnostiques déroge non seulement à la neutralité axiologique de la démarche scientifique, mais trahit, au-delà du parti pris, un flagrant contresens. En effet, le choix du texte de Bergson est particulièrement malvenu au regard de la laïcité, dès lors qu’il affirme que c’est à travers Dieu seul que le sentiment de fraternité peut être éprouvé. Cela contredit la nécessaire neutralité de la République, qui n’a pas à privilégier une option spirituelle parmi d’autres. Victor Hugo, poète croyant et fervent défenseur de la laïcité, s’abstenait quant à lui de faire l’éloge de la religion. Le SNALC s’étonne que précisément ce texte-là soit mis en avant car il bafoue la neutralité.
 On apprendra aussi dans ce « guide » que les enseignements de langues suscitent « la rencontre de l’altérité », ou encore que la démarche scientifique encourage les élèves « à adopter une posture commune d’être au monde ». Chaque page abonde de poncifs où le lecteur finit par se perdre.
On apprendra aussi dans ce « guide » que les enseignements de langues suscitent « la rencontre de l’altérité », ou encore que la démarche scientifique encourage les élèves « à adopter une posture commune d’être au monde ». Chaque page abonde de poncifs où le lecteur finit par se perdre.
Il se réveillera sans doute à la lecture de la conclusion (s’il parvient jusque-là) et de sa question-choc : « Qu’y a-t-il finalement de plus subversif qu’une pédagogie de la fraternité ? »
Un « guide » qui, s’il ne possède pas le super-pouvoir de faire advenir la fraternité, oriente résolument vers une École des compétences psychosociales. C’est d’ailleurs peut-être là, finalement, son côté réellement « subversif ».
Or, la fraternité souligne plutôt bien le civisme indispensable à la République. La force de la « chose publique » (en latin res publica) repose sur la dimension universelle des principes qui la fondent. Montesquieu définissait la vertu civique par « l’amour des lois et de l’égalité », vertu fondée sur l’adhésion consciente et réfléchie au triptyque républicain. N’oublions pas que la République a besoin de citoyens éclairés, prêts à la défendre, et que c’est d’eux qu’elle tient sa force.
Pour le SNALC, l’École ne saurait donc être réductible à un « savoir-être de la fraternité » que les auteurs appellent de leurs vœux. C’est par le Savoir seul, dispensé dans l’esprit des valeurs républicaines, que l’École peut accomplir ses finalités : former l’Homme, le citoyen, le travailleur.
Dans son commentaire de la devise républicaine, Victor Hugo met en évidence ce rôle politique de la fraternité comme médiation réciproque de la liberté et de l’égalité :
« La formule républicaine a su admirablement ce qu’elle disait et ce qu’elle faisait : la gradation de l’axiome social est irréprochable. Liberté-Égalité-Fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois marches du perron suprême. La liberté, c’est le droit, l’égalité, c’est le fait, la fraternité, c’est le devoir. Tout l’homme est là. » Le Droit et la loi (1875).
MENACES DE MORT : DES FAITS GRAVES À NE JAMAIS MINORER !
 Les menaces de morts deviennent courantes à l’encontre d’enseignants ou d’autres personnels. Face à leur répétition, toute tendance de banalisation ou de minoration doit être combattue.
Les menaces de morts deviennent courantes à l’encontre d’enseignants ou d’autres personnels. Face à leur répétition, toute tendance de banalisation ou de minoration doit être combattue.
Contrairement aux menaces de délit, les menaces de crimes (mort, viol, incendie) n’ont pas à être réitérées pour être punissables. Une seule menace de ce type suffit pour que l’auteur encoure une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 € (art. 222-17 Code pénal). L’objet de la menace, en suscitant la peur d’un mal, est d’intimider, de déstabiliser voire de contrôler la victime. Lorsque la menace de mort est adressée à un enseignant, l’atteinte est double. La personne est choquée psychologiquement. L’agent public est touché et, à travers, lui l’Institution et les valeurs de la République.
Les conséquences peuvent être très graves voire fatales. Dans l’Hérault, l’an passé, une collègue a démissionné, déclarant : « Menacée de mort et de viol, j’ai préféré arrêter. » Le 12 juin dernier, une professeure du collège L. Aubrac à Argenteuil a été menacée de mort par un courrier anonyme qui faisait référence aux assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Les enseignants de l’établissement ont exercé un droit de retrait. Le 1er septembre dernier, Caroline Grandjean, directrice d’école dans le Cantal, a mis fin à ses jours en raison de menaces de mort homophobes.
Pourtant, à Grandville, malgré des menaces de mort dirigées contre une professeure, un élève a été réintégré en cette rentrée dans son lycée, à la suite de l’appel de son exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline. Le sursis accordé par la suite a entraîné un mouvement de grève de toute l’équipe le 3 septembre. L’avocate de l’élève a plaidé que « le qualificatif infractionnel de menace de mort nécessite une intention », ce qui est fort litigieux puisque l’intentionnalité, fondement de tout délit, réside d’abord dans le fait de prononcer la menace et non dans celle potentielle et ultérieure de tuer.
Une menace de mort n’a donc pas à être estimée réelle ou peu sérieuse pour donner lieu à une prise en charge variable. Conformément à la loi, toute menace de mort, quelle qu’elle soit, doit être immédiatement et complètement traitée, tant elle fait grief.
Concernant la victime, une telle menace doit être déclarée comme un accident de service. La prise en charge des conséquences sur la santé sera ainsi renforcée par l’octroi d’un CITIS. D’autre part, en application de la note de service du 31-8-2023, et contre l’effet « pas de vagues », « chaque atteinte à la laïcité et aux valeurs de la République doit faire l’objet sans délai d’un signalement via l’application « Fait établissement » (au moins de niveau 2) par le chef d’établissement, l’IEN ou le directeur d’école ». De plus, en cas de présomption de danger imminent, la personne menacée peut exercer son droit de retrait. Attention toutefois à l’exercice collectif de ce droit ; seules les personnes directement menacées peuvent s’en prévaloir. Enfin la circulaire du 9-11-2022 (en annexe 5 du B.O. n°42) rappelle que « l’administration doit accorder d’office la protection fonctionnelle à son agent en cas d’atteinte aux valeurs de la République (…) de menaces ou tout autre intimidation ».

Concernant l’auteur, une plainte ou un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale doit être déposée à son encontre (contre X si la menace est anonyme) afin que des poursuites puissent s’enclencher et aboutir à une condamnation judiciaire. Si l’auteur est un élève, l’article R.421-10 du Code de l’Éducation impose au chef d’établissement d’engager ces poursuites pénales doublées d’actions disciplinaires. Cependant, sauf si une exclusion définitive est envisagée, rien ne l’oblige à saisir le conseil de discipline, ce qui pour le SNALC devrait être impératif. Dans l’attente d’un éventuel conseil, l’élève fautif pourra être exclu à titre conservatoire de l’établissement (art. D.511-33, Code de l’Éducation).
Face à de telles menaces, ne restez jamais seul. Contactez très rapidement votre section académique du SNALC qui saura vous soutenir et exiger que toutes les mesures de protection et de poursuites prévues par les textes soient bien mises en œuvre.
DES ACTIONS POUR ENGAGER LES ÉLÈVES

Le prix Samuel Paty, édition 2026, a pour thème : « Débattre pour faire vivre la démocratie ». Inscriptions jusqu’au 15.1.2026. Travaux à rendre pour le 30.4.2026.
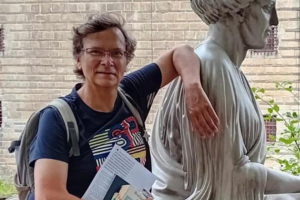
Le prix Dominique Bernard, qui a vu le jour dans l’académie de Lille, s’étend cette année à celles d’Amiens et de Normandie. Chaque académie distinguera ses lauréats avant qu’un jury interacadémique ne désigne les lauréats nationaux. (1)

Le prix Ilan Halimi vise à faire reculer les préjugés racistes et antisémites en valorisant « la mobilisation de la jeunesse française face aux discours et actes de haine, en encourageant les projets porteurs de fraternité, de respect de l’altérité et de solidarité. ». Public ciblé : écoliers, élèves du secondaire, étudiants de l’enseignement supérieur. Dossier à envoyer avant le 21.12.2025.
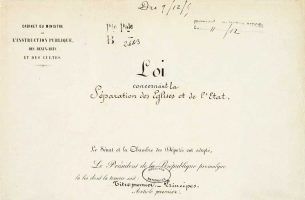
Appel à projets pour commémorer les 120 ans de la Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État. Candidatures jusqu’au 16.1.2026 mais les contributions peuvent être déposées jusqu’en juin 2026. Public ciblé : élèves du CM1 à la terminale.
.
(1) « Le Prix est ouvert aux élèves de 4e, 3e et 2de générale, technologique et professionnelle. “Lire, penser, écrire” est un prix littéraire destiné à encourager les collégiens et lycéens à s’emparer de l’écriture comme espace de liberté, de réflexion et de partage.
Ce prix poursuit trois grandes ambitions :
• Éveiller le goût du beau et de la création, à travers le plaisir d’écrire et de lire ;
• Développer l’esprit critique et d’analyse des élèves, en cultivant la finesse et la profondeur de la pensée ;
• Former de jeunes citoyens éclairés, dans l’esprit unificateur des valeurs de la République.
Chaque académie distinguera ses lauréats avant qu’un jury interacadémique ne désigne les lauréats nationaux. »
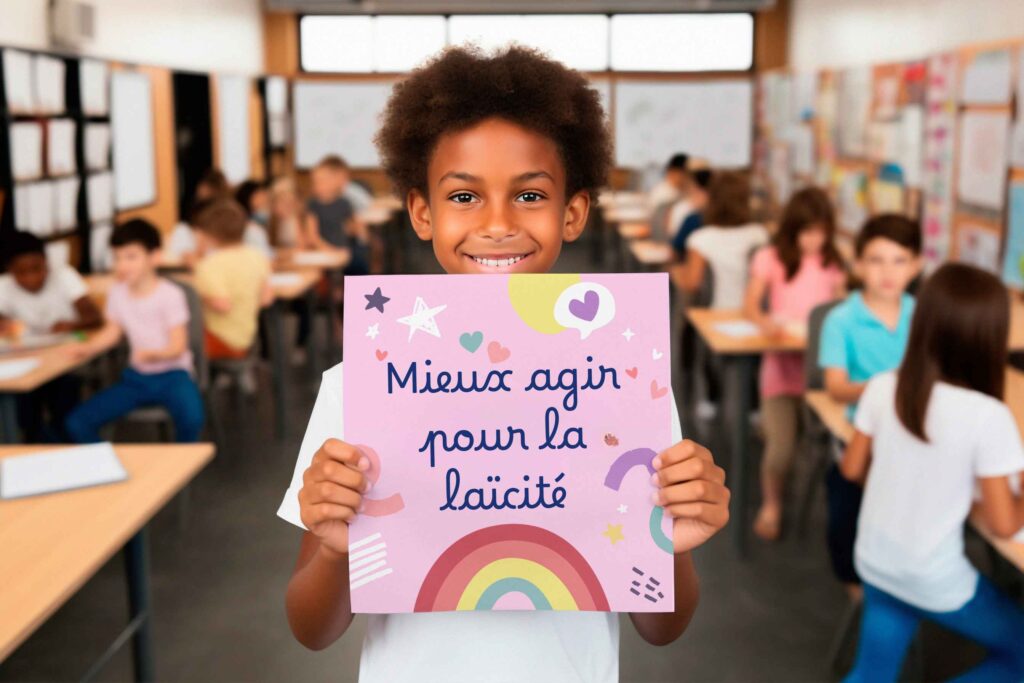
LES PROCHAINS CONGRÈS LAÏCITÉ DU SNALC
PARIS (SNALC Versailles)
17 octobre 2025
Invité : Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire-géographie, directeur de l’observatoire de l’éducation à la fondation Jean Jaurès.
PARIS (SNALC Paris)
17 novembre 2025
Invités : Jean-Pierre Obin, professeur des universités associé, et Frédérique de la Morena, professeur de droit public à l’Université de Toulouse-Capitole.
NANCY
25 novembre 2025
Invités : Catherine Kintzler, philosophe, et Stéphane Aurousseau, bénévole engagé dans la lutte contre les discriminations
STRASBOURG
9 décembre 2025
Invitée : Mickaëlle Paty. Elle sera interrogée sur son livre Le cours de monsieur Paty.
REIMS
2 décembre 2025 et 13 mars 2026
Invité 2 décembre : Jean-Pierre Obin ; 13 mars : Iannis Roder
Informations à venir
BOURGOIN-JALLIEU
3 avril 2026
Invité : Iannis Roder
Informations à venir





