Dossier du mois de la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1501 du 12 mai 2025.
Dossier rédigé par Sébastien VIEILLE, secrétaire national du SNALC chargé de la pédagogie, avec la contribution de Béatrice BARENNES, secteur SNALC Communication
Au menu dans ce dossier...
Cela fait des années que le SNALC défend des positions claires sur la formation initiale et continue des personnels de l’Éducation nationale, et plus particulièrement sur celle des professeurs.
Parler de l’ADN d’une organisation syndicale peut sembler galvaudé. Pourtant, si l’on veut comprendre l’action et les positions du secteur pédagogie du SNALC, il est important de connaître ce qui fait la singularité de notre syndicat. Hormis la défense et l’accompagnement des personnels, qui sont au cœur de l’engagement syndical, le SNALC s’appuie sur son secteur pédagogie pour promouvoir par ses actions et ses prises de position au Ministère, deux valeurs primordiales qui sont intrinsèquement liées : la liberté pédagogique et la défense d’un enseignement qui élève. Il n’est donc pas étonnant que notre magazine, la Quinzaine Universitaire, consacre un dossier à la question centrale de la formation des professeurs, car à l’entrée dans le métier comme tout au long de la carrière, sans une formation solide sur les contenus disciplinaires, ni la liberté pédagogique, ni la qualité de l’enseignement ne sont viables.
Pour le SNALC, la formation initiale doit avant tout permettre aux futurs professeurs de disposer d’un bagage culturel et intellectuel de grande qualité, d’une connaissance solide des différentes techniques pédagogiques existantes et de bases concrètes concernant la psychologie et le fonctionnement cognitif des enfants, adolescents et « adulescents » afin de pouvoir transmettre aux mieux des connaissances solides. La connaissance du fonctionnement de l’institution et des droits et devoirs d’un personnel de l’Éducation nationale ont un intérêt mais devraient relever de la formation continue du professeur et non constituer un élément à évaluer pour le recrutement.
Or, la formation continue est particulièrement mise à mal depuis deux ans. Le SNALC déplore une baisse de moyens conduisant à l’alourdissement de la charge de travail des professeurs, et à l’appauvrissement des contenus proposés.
Au final, en observant les formations présentes dans les plans académiques ou dans la formation initiale des futurs enseignants, il apparaît que les contenus disciplinaires sont réduits à la portion congrue. Le Ministère ne s’approprie pas cet adage selon lequel la folie consiste à faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, tant il s’entête dans des formations qui modèlent les pratiques en imposant des pédagogies lénifiantes, traitant de domaines qui ne font pas partie du cœur du métier ou qui visent même à façonner les consciences. Il ne se rend pas compte qu’en formant au développement durable, à être un « bon » fonctionnaire ou à la lutte contre les biais de genre, il peut avoir l’impression de sauver le monde, mais il ne lutte plus contre l’échec scolaire ni ne travaille à l’élévation du niveau de culture des élèves. Il confond finalités et objectifs ; c’est là un débat central qui demanderait sans doute un autre dossier.
PARTIE I : RÉFORMER LA FORMATION INITIALE
La place du concours : un vrai dilemme ou un faux problème ?
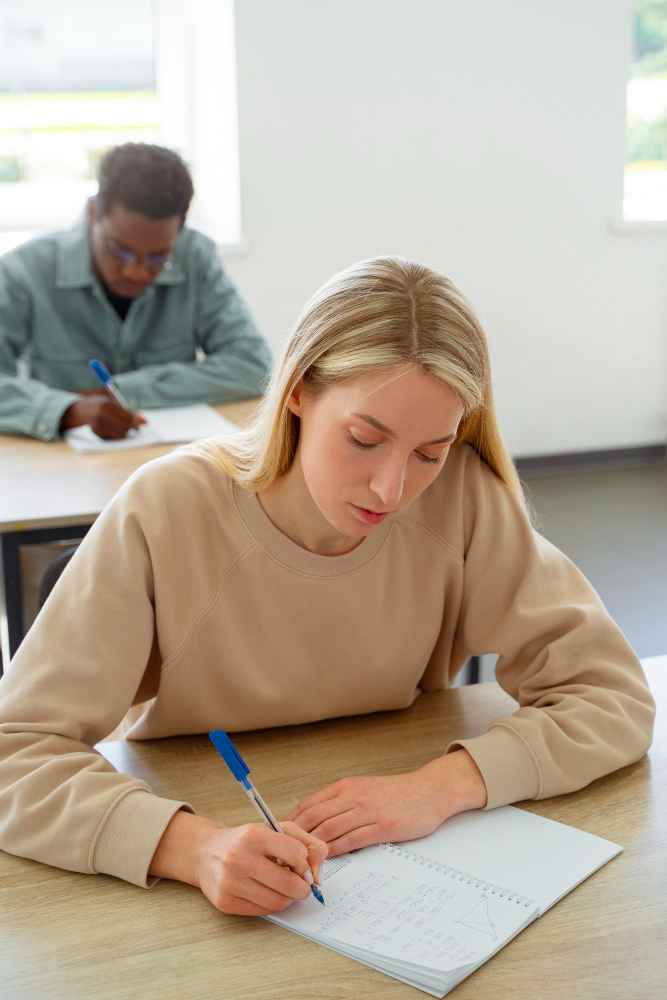
Parmi les points saillants de la réforme de la formation initiale, la place du concours fait couler beaucoup d’encre. Or, pour le SNALC, le concours durant l’année de licence n’est pas, intrinsèquement, l’horreur décrite par certains.
Il est vrai que le risque d’un appauvrissement disciplinaire est réel. Pour diverses raisons, il est incontestable que le niveau licence en 2025 n’a rien à voir avec celui qu’atteignaient les candidats de la fin des années 1990. Et même si le SNALC appelle de ses vœux une montée en gamme disciplinaire des différentes licences, il est conscient de l’immensité du défi dans le contexte actuel de l’enseignement supérieur.
Le SNALC aurait certes préféré que les candidats préparent le concours après validation de leur licence. Cette année supplémentaire leur aurait permis de consolider leurs connaissances disciplinaires pour répondre aux attendus d’un concours exigeant. Mais dans le cadre actuel de la masterisation, l’année de M1 aurait été intenable pour les nouveaux professeurs.
Il ne faut pas négliger non plus l’effet repoussoir des deux reculs successifs des concours à Bac+4, puis Bac+5. Sans en attendre d’effet magique, l’avancée de la date du concours est susceptible d’attirer davantage de candidats.
Bref, pour le SNALC, placer le concours en fin de L3 constitue un pis-aller dont les effets sur l’attractivité ou sur la qualité de la formation peuvent être limités par des facteurs beaucoup plus déterminants : la revalorisation générale de la profession –condition pour attirer de bons candidats- et la qualité disciplinaire de la nouvelle licence PE, du master consécutif au concours et le niveau d’exigence de ce dernier. Le SNALC est déterminé à se battre sur ces points cruciaux.
Concours, le nœud du problème
Au-delà de l’importante question de la qualité des diplômes, c’est la qualité du concours qui est au centre des préoccupations du SNALC. En effet, c’est de la variété et de l’exigence de ses épreuves que dépend le niveau des candidats recrutés. La meilleure preuve en est peut-être l’effondrement du niveau malgré l’allongement du cursus depuis la masterisation. N’est-ce pas en partie parce qu’on a simultanément édulcoré peu à peu les exigences du CAPES ? Pour le SNALC, les professeurs doivent être recrutés pour leur excellence disciplinaire.

Le concours et ses épreuves sont une sorte de lettre de commande de l’employeur, un moyen pour ce dernier de dresser un portrait-robot de celui, ou celle, qu’il souhaite recruter. Si le Ministère, comme il l’affirme, veut recruter d’excellents candidats passionnés par leur discipline et soucieux de la transmettre, il doit en tirer les conclusions.
Or, le SNALC, l’a déjà clairement exprimé en ce qui concerne l’actuelle mouture du concours. Nous nous opposons fermement à la seconde épreuve d’admission. Pour nous, elle confine à l’entretien d’embauche au cours duquel il faut se vendre et faire montre de sa capacité à donner à son auriculaire une belle rectitude sur la couture du pantalon. Ces qualités ne sont pas celles qu’il faut privilégier pour recruter. Le professeur doit rester un intellectuel, respectueux de sa hiérarchie certes, mais pas simple exécutant.
Malheureusement, désormais, les écrits nous inquiètent tout autant que cet oral d’embauche. En effet, nous avons pu observer les sujets 0 du CRPE et, disons-le tout net, le niveau n’était pas à l’image de ce que nous attendons de la part d’un professeur.
Quant aux maquettes des nouveaux concours récemment publiées, elles n’ont pas de quoi enthousiasmer. Citons simplement à titre d’exemple le CAPES de lettres modernes qui ne comporte désormais plus aucune question d’ancien français et toujours, aucune explication de texte ni à l’écrit ni à l’oral…
Pour le SNALC, les concours doivent être exigeants. Cela n’est sans doute pas une évidence pour tous, mais ils pilotent par l’aval la qualité des licences qui y mènent. Un concours solide mènera donc à des maquettes de formation de qualité, évitant ainsi que le passage du M2 à la L3 ne soit synonyme d’une perte de qualité.
L’obtention d’un concours exigeant est aussi garante de la légitimité du professeur et de son autorité dans la classe. C’est en ce sens que le SNALC défend un concours dans lequel les épreuves d’admissibilité permettent aux candidats de démontrer leur maîtrise de leur(s) domaine(s) alors que les épreuves d’admission viennent confirmer cette maîtrise et lui donner un éclairage pédagogique et didactique.
Nous l’avons déjà affirmé : la connaissance et la faculté de transmettre sont pour nous les seuls vrais piliers du métier de professeur
Licence PE, un gage de qualité ?
En tant qu’employeur et recruteur, le Ministère avait annoncé vouloir prendre la main sur la formation, ce qui avait de quoi inquiéter le supérieur. Finalement, il semble rester à mi-chemin dans une forme de « en même temps ».
Ainsi, tout en laissant à chaque université la possibilité d’ouvrir la licence professorat des écoles (LPPE) ou non, il définit cinq blocs très cadrants :
- Bloc 1 : savoirs ;
- Mathématiques et français : 240 heures ;
- Autres disciplines : 108 heures chacune ;
- Développement durable : 30 heures ;
- Approfondissement d’une discipline : 60 heures.
- Bloc 2 : pédagogie et fonctionnement cognitif des élèves ;
- Bloc 3 : aspects institutionnels et enjeux éducatifs (développement durable, numérique, citoyenneté, éducation aux media) ;
- Bloc 4 : stages et analyse de la pratique.

Le bloc 1 représentant 1 110 heures contre 120 pour chacun des trois autres (et un volume de 100 heures laissé à l’appréciation locale pour le renforcement d’un des blocs), on peut considérer que les savoirs ont la part belle. Le SNALC estime cependant que les questions liées à l’institution ou à la posture du fonctionnaire pourraient attendre le master ce qui permettrait de consolider encore les disciplines tout en les articulant avec de la pédagogie et de courtes périodes d’observation.
Pour le SNALC, l’avancée du concours à la L3 ne doit pas constituer une perte de savoirs ni l’opportunité de créer une licence professionnalisante propice au formatage. Une licence solide scientifiquement doit permettre aux lauréats de concours d’entrer sereinement dans le métier.
Un master flou dangereux

Une fois le concours obtenu, les lauréats – qu’ils intègrent le premier ou le second degré, bénéficieront de deux années de formation. Rien ne dit dans le décret publié le 17 avril qu’il s’agit d’un master, mais ce sera bien le cas et un arrêté doit venir le préciser. Et, le moins que l’on puisse dire est que ce master pose de nombreuses questions.
En premier lieu, le SNALC attend des précisions sur les contenus. Compte tenu de l’avancée du concours en L3, il attend que ce master, notamment en M1, propose un véritable rattrapage du déficit de maîtrise disciplinaire prévisible.
Autre question cruciale, le Ministère entend cantonner les lauréats du concours dans un master enseignement. Le SNALC insistera inlassablement : les enseignants doivent pouvoir accéder à des masters de recherche pour éventuellement passer l’agrégation et/ou accéder à un doctorat. Enfermer les étudiants dans une voie n’est pas la meilleure manière d’attirer des candidats ni de favoriser la qualité scientifique de nos universités.
Lorsque le SNALC alerte le Ministère sur ce problème, ce dernier répond – un tantinet à côté du sujet, sciemment sans doute – que les titulaires d’un master disciplinaire pourront toujours s’inscrire au futur concours de niveau L3. La belle affaire ! Ils entreraient alors comme stagiaires et, en l’absence de texte clair à ce sujet, bien malin qui pourrait dire s’ils devront valider le M2 enseignement, ce qui serait d’une stupidité sans nom.
De même, les étudiants en M1 disciplinaires pourront passer le concours. Ce faisant, ils seront reversés dans le master enseignement, soit en M1, soit en M2. Selon quels critères ? Rien n’est clair sur ce point non plus.
En revanche, il est établi que les M1 seront des élèves fonctionnaires qui toucheront 1 400 euros par mois pour se former avant de devenir stagiaires en M2, s’ils n’ont pas montré des insuffisances manifestes. Il est également acté que tous les futurs lauréats s’engageront à rester quatre ans dans l’Éducation nationale, sous peine de pénalités financières, qu’ils soient passés par le M1 enseignement ou non. Sur quelle base et quel montant ? Là encore, c’est flou.
Pour le SNALC, il est encore temps de remettre l’ouvrage sur le métier. Il faut clarifier, permettre l’ouverture sur d’autres masters et laisser tomber les pénalités financières. Il est en effet totalement incohérent de s’attaquer au repoussoir de l’allongement des études pour instaurer de nouveaux repoussoirs. Les salaires versés risquent bien de ne pas faire le poids : peut-on vraiment attirer d’excellents candidats en les coinçant pour quatre ans dans une voie sans possibilité de reconversion alors même que les carrières proposées n’attirent plus faute de revalorisation significative et d’amélioration des conditions de travail ?
PARTIE II : LA FORMATION CONTINUE
Le nerf de la guerre
Certes, la question des moyens est une antienne syndicale usée jusqu’à la corde. Il faut néanmoins se rendre à l’évidence : dans le domaine de la formation, le Ministère ne se donne pas les moyens de ses ambitions.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les comptes-rendus des CAPA de refus de congés formation. Selon les académies, il faut entre cinq et sept demandes consécutives pour espérer obtenir le Graal. En outre, pénurie oblige, les formations institutionnelles telles que le passage de l’agrégation, sont privilégiées malgré le discours du Ministère exaltant la mobilité et l’épanouissement professionnel.
Désormais, les formations longues ne sont plus les seules à pâtir du manque de moyens. En cela, le second degré rejoint d’ailleurs le premier degré… pour le pire.

Certes, cela se concrétise différemment. Dans le premier degré, on annule des formations faute de moyens de remplacement. Dans le second degré, on s’arrange pour faire des formations hors temps scolaire.
L’argument de l’intérêt de l’élève qui ne doit pas manquer une seule heure de cours pour ce motif – quand se multiplient voyages scolaires, sorties et diverses sensibilisations dévoreuses d’heures de cours – est brandi pour refuser les formations demandées ou réduire des formations d’une journée en deux heures de webinaire.
Le SNALC s’insurge contre cette logique de comptable à la petite semaine. La formation continue des enseignants, lorsqu’elle est de qualité, est un investissement. Entretenir les compétences et la motivation des professeurs ne peut que s’avérer bénéfique à l’ensemble du système.
La formation continue est un droit. En tant qu’employeur, le Ministère a la responsabilité de former ses agents en s’assurant au besoin des moyens de remplacement nécessaires.
La « formation asynchrone », nouvelle panacée ?

Séduite par la flexibilité de formations qui peuvent être suivies en dehors des cours à la maison ou depuis l’établissement scolaire, notre institution a favorisé le développement de webinaires sur la plateforme M@gistere. Dgesco, réseau Canopé et collègues qui maîtrisent l’outil informatique y proposent des parcours de formation intéressants.
Séduite par la flexibilité de formations qui peuvent être suivies en dehors des cours à la maison ou depuis l’établissement scolaire, notre institution a favorisé le développement de webinaires sur la plateforme M@gistere. La Dgesco, le réseau Canopé et des collègues qui maîtrisent l’outil informatique y proposent des parcours de formation intéressants.
Où sont passées les formations disciplinaires ?
Au-delà de la question des moyens, les contenus proposés revêtent une importance capitale. Or, depuis plusieurs années, le Ministère est pris d’une réformite aigüe. De plus en plus de formations visent donc à assurer le service après-vente des réformes. Ajoutez à cela les grands enjeux modernes comme le numérique, l’inclusion, le développement durable et la lutte contre le harcèlement et vous aurez à peu près fait le tour de la totalité de l’offre de formation. Le disciplinaire semble en avoir totalement disparu, si ce n’est dans les fameux plans du premier degré.

Pour le SNALC, la formation doit permettre d’entretenir et de recycler les connaissances scientifiques et disciplinaires des professeurs. C’est la position qu’il défend dans les groupes de travail ministériels sur l’élaboration du schéma directeur de la formation. Il est souvent bien désappointé : en effet, lorsqu’il est question de s’appuyer sur la recherche, ces groupes de travail ne mentionnent que les sciences de l’éducation et il n’est jamais question de lettres, de philosophie, d’histoire ou de mathématiques…
Pour mieux répondre aux besoins des professeurs, le SNALC suggère aussi le développement systématique d’un recueil des besoins. L’IGESR déplorait d’ailleurs dans son rapport d’août 2024 que « le recueil des besoins demeure embryonnaire ».
Inspecteurs, conseillers RH de proximité, chefs d’établissement pourraient être mis à contribution à cet effet : pourquoi ne pas utiliser les rendez-vous de carrière, entretiens professionnels et autres temps d’échange pour faire un état des lieux des besoins des agents ? À l’heure du numérique et alors que les questionnaires de satisfaction se multiplient dans tous les domaines, proposer un pavé d’expression pour signaler un manque ou un besoin à la suite du plan académique de formation ne semble pas non plus relever de la science-fiction ! Craindrait-on de constater l’inadéquation entre l’offre et la demande ?
Enfin, il est un pan que le SNALC réclame absolument, c’est celui de l’évolution professionnelle, qu’elle soit interne ou externe. Notre employeur nous la doit, même s’il semble l’oublier.
Le chantier est immense, mais l’enjeu en vaut la chandelle. Il ne suffit pas d’attirer de nouveaux candidats. Il faut aussi proposer des perspectives de carrière suffisamment attrayantes pour endiguer les abandons, les départs et les démissions qui ne font qu’augmenter dans le contexte actuel. Le Ministère a-t-il pris la mesure des enjeux ? Quoi qu’il en soit, le SNALC saura les lui rappeler.

Enquête du SNALC
L’accompagnement des professeurs
Selon les lignes directrices de gestion publiées ces dernières années, l’accompagnement des personnels dans l’Éducation nationale est une politique cruciale visant à garantir le bien-être et le développement professionnel des agents. Celle-ci repose sur trois piliers : personnalisation, proximité et accompagnement des parcours professionnels.






