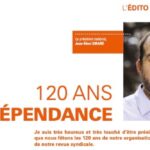Le SNALC n’est pas né de la dernière pluie. Il vit le jour en 1905 sous la forme d’une Fédération nationale des professeurs des lycées de garçons et de l’enseignement secondaire féminin. Au nom de la « valeur de l’enseignement secondaire », il s’est d’abord opposé à la transformation des « professeurs adjoints » (simples bacheliers) en professeurs à part entière, ensuite à la surveillance par les professeurs des « récréations d’interclasse », tâche jusqu’alors dévolue aux répétiteurs. En 1925, le syndicalisme étant autorisé aux agents de l’État, la fédération se transforme en Syndicat national des professeurs des lycées de garçons et du personnel de l’enseignement secondaire féminin. En juin 1927, pour protester contre la situation financière des professeurs, il organise une grève du baccalauréat. En 1937, Le syndicat se transforme alors en Syndicat national des lycées, collèges et cours secondaires.
La suite de son histoire montre son refus constant de toute compromission. Doyen des syndicats, il a, à plusieurs reprises, rejeté des fusions avec d’autres syndicats politisés. Ce qui a entraîné des scissions ayant elles-mêmes donné naissance à d’autres syndicats.
Sous Vichy, le syndicat est interdit. Beaucoup de ses adhérents et de ses dirigeants sont prisonniers en Allemagne. À la Libération, le SNALC a une nouvelle fois refusé de participer à un rapprochement entre syndicats du 2nd degré. Une nouvelle tentative de rapprochement au sein de la CGT a abouti à la création du SNES. Le futur SNALC s’est abstenu de participer à ce processus.
En 1949, il adopte son sigle actuel de « SNALC » pour « Syndicat national des lycées et collèges ».
Quelles ont été les positions du SNALC depuis ? L’illustration de sa défense concrète des intérêts des professeurs :
1975 : opposition à la réforme du « collège unique », du ministre Haby
1985 : soutien à la création des baccalauréats professionnels du ministre Chevènement
2004 : soutien à la loi sur le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles (seul syndicat à avoir voté pour), du ministre Ferry
2007 : opposition à la bivalence des professeurs de l’enseignement général, du ministre de Robien
2015 : opposition au socle commun, de la ministre Vallaud-Belkacem
2016 : opposition au PPCR, de la ministre Vallaud-Belkacem
2017 : soutien à l’assouplissement de la réforme du collège (seul syndicat à avoir voté pour)
2019 : opposition à la seconde heure supplémentaire hebdomadaire non refusable par les professeurs et à la nature et durée des épreuves terminales du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2021, du ministre Blanquer
2022 : soutien à la réforme ouvrant plus largement l’accès à la classe exceptionnelle, du ministre Blanquer
2025 : opposition au projet de plan national de formation 2025-2026, de la ministre Borne.