Dossier du mois de la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1504 du 5 septembre 2025.
Dossier coordonné par Élise BOZEC-BARET, secrétaire nationale du SNALC chargée des conditions de travail et du climat scolaire. Avec la collaboration de Maxime REPPERT, vice-président du SNALC, Luc PAVAN et Ségolène EXSHAW, membres de l’équipe SNALC Conditions de travail.
Sommaire
UNE RENTRÉE CHAUDE
La fin de l’année scolaire a vu la première canicule de l’été perturber les derniers cours, les examens et leurs corrections : rien d’improbable à ce que cette rentrée connaisse a minima une vague de chaleur, et pas seulement au sens propre au vu des récentes annonces qui l’accompagnent !
 Le SNALC s’inquiète du sous-investissement chronique dans le bâti scolaire, pour lequel l’Etat et les collectivités territoriales ne cessent de se renvoyer la balle : que ce soit au sujet de l’ambiance thermique, la présence d’amiante, la sécurité matérielle de façon générale, il n’existe toujours pas d’état des lieux objectivé ! Seuls 7 % des établissements ont un DPE (diagnostic de performance énergétique), par exemple.
Le SNALC s’inquiète du sous-investissement chronique dans le bâti scolaire, pour lequel l’Etat et les collectivités territoriales ne cessent de se renvoyer la balle : que ce soit au sujet de l’ambiance thermique, la présence d’amiante, la sécurité matérielle de façon générale, il n’existe toujours pas d’état des lieux objectivé ! Seuls 7 % des établissements ont un DPE (diagnostic de performance énergétique), par exemple.
Quelques avancées législatives, comme le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, ou des plans ministériels remplis de bonnes intentions, comme celui sur l’égalité entre les femmes et les hommes, viennent en apparence renforcer les droits des agents : mais où sont les moyens pour les faire appliquer ? Encore une fois, on déplore la fâcheuse manie du gouvernement d’annoncer des actions sans les budgétiser.
Et avec tout ça, si encore l’Institution accompagnait de façon humaine et valorisante ses personnels ! Loin de là, comme en témoignent les résultats effarants de notre enquête sur l’accompagnement des enseignants !
Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les chiffres récoltés par la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) sur le vécu au travail des personnels révèlent, à qui sait les décoder, une exposition de plus en plus grande aux risques psychosociaux.
En cette rentrée, dans un contexte de plus en plus anxiogène et dangereux, sachez que le SNALC est toujours à vos côtés : pour dénoncer, revendiquer, mais surtout pour vous accompagner au mieux, car pour nous, l’humain doit être au cœur des préoccupations.
LA PAROLE EST À VOUS : EN SURCHAUFFE !
Deux enseignants partagent ici leur perception de l’année scolaire écoulée.
Agnès
L’année 2024/25 se termine et cette fin d’année m’a paru interminable : conseils de classes qui s’éternisent, réunions diverses et variées …. Le 4 juillet est une vraie libération !
Libération aussi par rapport à un collège en surchauffe ! Des classes dans lesquelles on ne peut plus faire cours (plus de 30 degrés à l’intérieur !), un épuisement du corps qui reste des heures durant dans une atmosphère de canicule. Ajoutons également que des fenêtres ne s’ouvrent pas (le Conseil Départemental doit effectuer des travaux sur les huisseries… que l’on attend depuis cinq ans !). Certaines fenêtres ferment avec des manches à balai mais le Conseil départemental préfère embaucher un « responsable » en communication ! La solution de « faire cours dehors », pratiquée par certains collègues qui n’en peuvent plus, n’est pas la panacée : quid du matériel ? Quid des tables pour écrire ? Quid des tableaux ? Soyons sérieux : cette « solution » ne peut se substituer à des travaux d’envergure pour isoler les bâtiments. Quand on pense que le président de la République souhaite que les élèves de France puissent avoir cours en juillet et août alors qu’on ne peut même pas leur assurer des conditions de travail convenables avec une température acceptable en juin… On marche sur la tête ! […]
Guillaume
L’année scolaire qui s’achève a été pour moi la plus difficile de toute ma carrière. J’ai dû enseigner ma matière dans des conditions très dégradées (horaires amputés, cours systématiquement placés le soir, regroupement de niveaux, 13h de trous dans le service, effectifs en berne, désintérêt de la part de la hiérarchie, aucune perspective d’évolution) qui m’ont conduit à un burn-out et un épisode dépressif sévère.
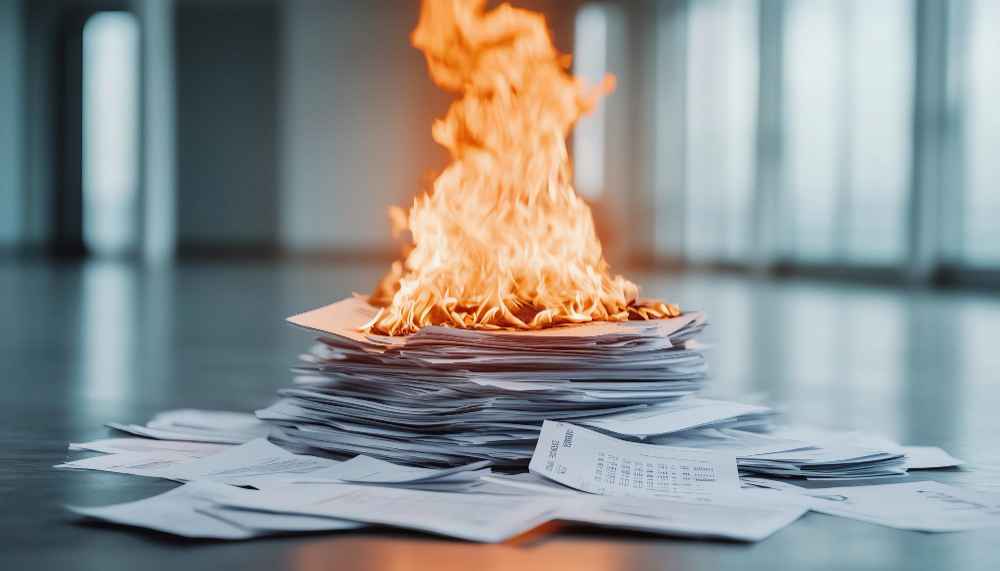
Heureusement, j’ai été soutenu et accompagné par les collègues de mobi-SNALC dans les démarches d’octroi d’un congé long. Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’être recruté sur un poste dans l’ingénierie de formation et, pour la première fois depuis de longues années, j’aborde la prochaine rentrée avec l’enthousiasme de la découverte de mes nouvelles fonctions.
VERS DES RENTRÉES PLUS SEREINES POUR LES PARENTS AGENTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE ?
Angoisse et urgence semblent dominer au moment de la rentrée, tant à l’école que dans les familles. Le SNALC alerte sur la situation de ceux qui vivent la rentrée à la fois comme parents et personnels de l’Éducation nationale.
 Double rentrée pour eux, et cela tient souvent de la quadrature du cercle. Comment organiser l’emploi du temps de ses propres enfants pour l’année lorsque l’on n’a le sien que la veille de la rentrée ? Comment trouver une nounou quand on ne sait pas quand on aura besoin d’elle ? Comment emmener le petit à sa rentrée si l’on doit aussi accueillir, en tant que professeur principal, les enfants des autres ? Comment garder un peu de temps pour ses propres enfants si l’on peaufine les emplois du temps d’un établissement entier sur les derniers jours précédant la rentrée ? Personnels de direction et professeurs ne savent souvent comment répondre à ces questions, sinon par un sentiment d’angoisse et une surcharge de travail et d’activités durant le mois de septembre, le temps que « les choses se mettent en place ».
Double rentrée pour eux, et cela tient souvent de la quadrature du cercle. Comment organiser l’emploi du temps de ses propres enfants pour l’année lorsque l’on n’a le sien que la veille de la rentrée ? Comment trouver une nounou quand on ne sait pas quand on aura besoin d’elle ? Comment emmener le petit à sa rentrée si l’on doit aussi accueillir, en tant que professeur principal, les enfants des autres ? Comment garder un peu de temps pour ses propres enfants si l’on peaufine les emplois du temps d’un établissement entier sur les derniers jours précédant la rentrée ? Personnels de direction et professeurs ne savent souvent comment répondre à ces questions, sinon par un sentiment d’angoisse et une surcharge de travail et d’activités durant le mois de septembre, le temps que « les choses se mettent en place ».
Cette période difficile va-t-elle aller en s’améliorant dans les prochaines années ? Pour le SNALC, c’est impératif. Le ministère de l’Éducation nationale, dans son récent « Plan national d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » semble prendre conscience de la réalité du problème : on y lit que « les exigences émotionnelles et organisationnelles fortes liées aux difficultés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et à des horaires de travail contraints sont des facteurs de risques psychosociaux qui apparaissent plus particulièrement à prendre en compte dans la prévention de l’usure professionnelle psychique et physique ».
Le SNALC revendique que la diffusion plus précoce des emplois du temps des professeurs durant l’été se généralise, et que « l’ensemble des droits des parents » que le ministère se propose de recenser dans un document unique courant 2026 soient respectés sans qu’il soit besoin de le demander. La santé des personnels et le respect de leurs droits ne sont pas négociables pour le SNALC, pas même début septembre.
VÉCU AU TRAVAIL : UNE NOTE À LIRE ENTRE LES LIGNES

Le 16 juillet 2025, la DEPP a publié une note d’information sur le vécu au travail des personnels du second degré durant l’année 2023-2024. L’abstract indique que « la majorité des personnels du second degré se sentent respectés par les élèves et en sécurité dans les collèges et lycées où ils ont exercé durant l’année scolaire. Un sur deux estime que la violence y est absente ou marginale ».
Face à ces constats plutôt optimistes, le SNALC tient à vous faire part de son analyse plus nuancée de l’évolution des RPS (risques psychosociaux) durant ces dernières années. Pour cela nous nous appuierons sur la classification mise en évidence par le rapport Gollac, référence dans la fonction publique, qui décrit 6 types de risques.
Après analyse des données fournies par la DEPP (35 000 répondants à l’enquête) et comparaison avec les données de 2018-2019, voici nos observations :

1.Charge et intensité de travail : Si le chiffre est en hausse (+10 pts), seulement 52 % des personnels (½) estime disposer d’un temps suffisant à la réalisation de leur travail. Ce risque est encore plus marqué chez les personnels de direction qui ne sont qu’1 sur 4 environ (28 %) à considérer disposer d’un temps suffisant.
Par ailleurs, de moins en moins de personnels s’estiment capables d’exercer le même métier jusqu’à leur retraite (- 6 pts) et ils pensent de plus en plus ne pas être assez nombreux (- 2 pts).
2.Autonomie et marges de manœuvre dans la situation de travail : Le flou organisationnel semble s’accentuer : les personnels estiment de moins en moins disposer d’informations claires pour organiser leurs pratiques professionnelles (- 16pts). Ce manque de clarté a même parfois tendance à générer un stress croissant. Et même s’ils estiment encore majoritairement pouvoir organiser leur travail de la façon souhaitée (78 %), cet indicateur est en baisse (– 3pts).
De plus, le sentiment d’être soumis à des changements trop rapides augmente (+10 pts), ce qui nous semble corrélé à l’augmentation des injonctions contradictoires. Quant aux contraintes matérielles, elles se font de plus en plus sentir puisque le nombre de collègues qui pensent ne pas disposer de moyens suffisants augmente (+ 6pts) alors même qu’il semble de plus en plus difficile de développer ses compétences professionnelles (+ 3pts).
3.Exigences émotionnelles : La prévalence de l’exposition à des marques d’arrogance ou de mépris reste élevée (42 %), tandis qu’environ un enseignant sur quatre fait face à la contestation ou au refus d’exercice de ses missions (27 %). Plus d’un sur deux (57 %) a subi au moins une atteinte, ce qui traduit une pression émotionnelle constante et soutenue, particulièrement forte en éducation prioritaire. Environ 2 sur 3 estiment avoir reçu un soutien satisfaisant dans les situations difficiles, comme en 2018.
4.Rapports sociaux et relations au travail : L’indicateur « faire partie d’une équipe » chute fortement (- 14 pts), révélant un isolement professionnel croissant. On observe également une baisse du sentiment de ne pas être exploité (- 10 pts) et un recul de la solidarité dans l’établissement (- 4 pts). Les personnels ressentent une perte de soutien social et une plus grande distance avec la hiérarchie (- 3 pts), dégradant l’ambiance collective.
5.Conflits de valeurs : Les personnels sont un peu moins nombreux à voir leur métier comme « utile aux autres » (- 3 pts) et à déclarer faire des choses qui leur plaisent (- 5 pts). Cette baisse indique une perte progressive de sens.
6.Insécurité de la situation de travail :
La majorité des personnels continue à se sentir en sécurité dans l’établissement (– 2 pts). Le niveau de violence ressenti reste stable (+ 2 pts). Toutefois, cette stabilité contraste avec une forte exposition aux incivilités du quotidien. Quant au sentiment de violences peu présentes, il ne concerne toujours qu’un personnel sur deux.
L’analyse approfondie de cette note d’information confirme donc ce que le SNALC constate au quotidien : une dégradation plurifactorielle de l’exposition aux RPS depuis 2019.
Le SNALC note un recul de la considération apportée aux collègues, une perte d’autonomie et un glissement éthique subtil. Seule la perception d’avoir du temps pour réaliser son travail progresse, probablement par rationalisation face aux profs bashing ambiant. Concernant la question des violences et de la sécurité, nul doute que la surexposition médiatique aux ultraviolences amène bon nombre de collègues à relativiser leur quotidien et à accepter aujourd’hui ce qui était encore inconcevable il y a quelques années.

Pour le SNALC, qui demande depuis longtemps une prise en compte des RPS auxquels sont soumis les collègues, cela n’est plus acceptable. Il est grand temps pour l’administration de prendre ses responsabilités en tirant la leçon de ses propres données.
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS : DES DYSFONCTIONNEMENTS CRIANTS
Le SNALC a mené en 2025 une enquête sur l’accompagnement des enseignants dans l’Éducation nationale, recueillant les témoignages de 3 528 professeurs, au profil représentatif. Le bilan est sans appel !
En résumé
La réforme PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) avait cinq objectifs principaux : améliorer l’accompagnement des enseignants, favoriser l’évolution professionnelle, améliorer la reconnaissance du mérite, réduire le stress lié aux inspections, et développer la formation continue.

Or, l’évaluation de ces objectifs au travers de l’enquête aboutit à un indice global de satisfaction de 30,1 %, ce qui est très faible. L’écart entre les ambitions réformatrices et la réalité vécue traduit une méconnaissance des besoins réels des enseignants et une approche descendante inadaptée aux spécificités du métier.
Loin de la promesse d’un « accompagnement renforcé » et de rendez-vous de carrière « structurants », les dysfonctionnements antérieurs persistent voire s’aggravent. Les remontées du terrain confortent ainsi l’opposition initiale du SNALC au PPCR.
Le taux d’insatisfaction de 70,7 % concernant les formations obligatoires est significatif. Plus préoccupant encore, l’impact négatif des inspections sur le bien-être (67,60 %) indique que le dispositif d’évaluation, pilier de la réforme, produit des effets contraires à ses objectifs déclarés.
Sur l’indicateur final de l’enquête, mesurant le sentiment d’être accompagné efficacement par l’institution, seuls 7,6 % des enseignants expriment une satisfaction, tandis que 91,8 % manifestent leur insatisfaction. Cette proportion très élevée d’insatisfaction suggère non pas une simple inadéquation, mais une véritable crise systémique de l’accompagnement des enseignants.
Pour le SNALC, l’ampleur des dysfonctionnements ne nécessite pas seulement des ajustements techniques, mais une refonte complète de l’accompagnement professionnel sur des bases saines : la reconnaissance, l’autonomie et l’équité territoriale. C’est la condition sine qua non pour que l’EN attire et retienne ses personnels dans un contexte de crise du recrutement sans précédent.
Lien vers l’analyse complète des résultats :
SANTÉ MENTALE EN PILOTAGE AUTOMATIQUE : ATTENTION AU CRASH !
Si le SNALC n’a pas participé aux très médiatiques assises de la santé scolaire du 14 mai, il est resté attentif à ses suites. Or, une revendication qu’il porte de longue date semble (enfin) avoir été prise en considération : l’annonce d’une formation à la santé mentale pour les personnels de direction (et IEN du 1er degré).
 Après la mise en place du programme pHARe sur le harcèlement scolaire, il semble logique que les cadres soient désormais sensibilisés à la santé mentale, grande cause nationale. Cela pourrait faire évoluer les modalités d’accompagnement non seulement des élèves, mais aussi des personnels.
Après la mise en place du programme pHARe sur le harcèlement scolaire, il semble logique que les cadres soient désormais sensibilisés à la santé mentale, grande cause nationale. Cela pourrait faire évoluer les modalités d’accompagnement non seulement des élèves, mais aussi des personnels.
Cependant, la formation prévue interroge : deux parcours m@gistère (donc en distanciel) sont censés aider nos cadres à piloter la mise en œuvre des protocoles de santé mentale – qui auraient dû, au passage, exister depuis un an.
Après avoir été estampillés pilotes en pédagogie et en lutte contre le harcèlement les voici donc pilotes en santé mentale… sans jamais avoir passé le moindre brevet ! Le risque paraît donc grand que l’avion s’écrase avec son pilote et ses passagers.
Car malgré toute la bonne volonté que nos cadres pourraient déployer, le risque est fort de générer un effet Dunning-Kruger (biais de « surconfiance »), qui laisse croire à des personnes peu formées qu’elles seraient compétentes dans un domaine.
Ce phénomène s’avère dangereux et peut conduire à une verticalité hiérarchique importante qui verrouillerait l’empathie. La posture attendue serait en effet, à la manière d’un général, de développer une vision stratégique que les équipes, seules expertes sur le terrain, pourraient mettre en œuvre grâce à une vision tactique… Ce type de gouvernance semble bien éloigné du leadership scolaire présent dans une bonne partie de l’Europe et censé être valorisé par l’IH2EF.
Face à ce constat, le SNALC s’inquiète de la potentielle multiplication des burn-out, ce qui serait un comble si l’on souhaite améliorer la santé mentale dans les établissements scolaires ! Le SNALC demande que les moyens consacrés à cet objectif soient à la hauteur des annonces, des enjeux et surtout déployés dans le respect de l’expertise de chacun.
VIOLENCE ET INSÉCURITÉ : FACE À UNE RÉALITÉ INACCEPTABLE, UNE GESTION MINABLE

Parler de violences à l’école, ce n’est plus parler d’un épiphénomène, de quelque chose de marginal. Cette violence fait aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Enseigner devient de plus en plus un métier à risques. C’est d’ailleurs une situation qui touche tous les personnels de l’Éducation nationale ainsi que les élèves.
Violences verbales, physiques, psychologiques. Des blessés, des morts, un climat suffocant. La médiatisation croissante des faits de violence à l’École témoigne de cette évolution. Chaque année maintenant, nous comptons le nombre d’attaques subies. L’École devient de plus en plus la cible d’une violence banalisée, une violence installée.
À chaque fois qu’un drame se produit, le SNALC est sollicité dans les médias pour réagir. À chaque fois nous pensons aux victimes. À chaque fois, nous nous indignons. Mais plus encore, forts de notre indépendance et de notre représentativité, nous dénonçons, proposons, exigeons.
Pourtant, force est de constater, qu’à chaque fois le gouvernement, comme les politiques sont à côté de la plaque. Pire : ils font la démonstration d’une gestion catastrophique de la situation.
Que ce soit lors de la mort de Mélanie G. à Nogent en juin dernier, celle d’une élève tuée à Nantes en avril dernier, ou celles d’Agnès Lassalle et Dominique Bernard en 2023, on constate à chaque fois le même refrain macabre chanté par le gouvernement : on s’indigne avant d’embrayer sur une surenchère de déclarations marquées par le tout-sécuritaire. C’est ainsi qu’on nous sert régulièrement la question des portiques, la question des contrôles devant les établissements, etc.
Mais quid de la santé mentale des jeunes ? Quid de la formation des personnels à ce niveau ? Quid du manque d’effectif des professeurs et des personnels encadrants ? Quid des classes surchargées qui parasitent le climat scolaire ? Quid de la responsabilisation des parents et des élèves ? Quid des excuses de minorité ? Les portiques ne résoudront pas le problème, pas plus que les contrôles aléatoires – c’est d’ailleurs à cette occasion que Mélanie G. a été assassinée.
Pour le SNALC, les enjeux sont ailleurs : la santé mentale, la responsabilisation des élèves et des parents, l’importance de la fermeté. Certes, cela nécessite de la volonté, de l’audace et une politique intelligente, cohérente sur le long terme. On ne peut demander à l’École d’endosser le rôle et la responsabilité des parents. Nous ne sommes pas là pour élever les enfants des autres.
Et pourtant, en dépit de ce bon sens, en dépit des alertes d’un syndicat de terrain comme le nôtre, dont les alertes sont d’ailleurs fréquemment relayées par la DEPP ou la médiatrice, le gouvernement s’entête à raisonner de travers.
Ainsi, alors qu’il pratique des suppressions de postes et n’investit pas pour la santé des élèves et des personnels sous couvert d’économies, l’État encourage les collectivités (régions, départements) à financer des portiques de sécurité, à organiser des fouilles aléatoires sur du court terme, à investir dans la construction massive de casiers pour les téléphones portables dans les collèges au lieu de responsabiliser les parents sur cette question.
Et pendant ce temps :
- Le bâti scolaire (isolation, amiante…) est délaissé.
- La santé des élèves et des personnels est oubliée.
- La responsabilisation des élèves et des parents est ignorée.
- Les collègues se sentent abandonnés.
- L’insécurité et le danger se développent.
Mais pas de soucis, on a des millions pour des portiques de sécurité et des casiers pour téléphone portable. Avec ça, l’École est sauvée (ou pas).
Au SNALC, nous appelons cela une gestion minable. Inacceptable !







